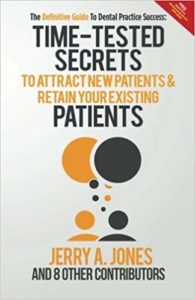Ce n’est plus révéler un secret que de dire que les actions, tout comme les obligations, ont des performances médiocres dans un environnement inflationniste. Nous avons été dans ce genre d’environnement sur la majorité de la décennie passée, et ce fut effectivement une époque difficile pour les actions. Mais les raisons des problèmes qu’ont rencontrés les marchés d’actions dans cette période ne sont pas encore parfaitement comprises.
Par contre, il n’y a aucun mystère à expliquer les problèmes des produits obligataires dans un environnement inflationniste. Alors que la valeur du dollar se détériore mois après mois, un titre dont les revenus et le remboursement du principal sont libellés en dollars a peu de chances de bien performer. Pas besoin d’avoir un doctorat en économie pour le comprendre.
Longtemps, l’on a cru que les choses étaient différentes pour les actions. Pendant des années, il était communément admis que les actions représentaient une protection contre l’inflation. Cette assertion était enracinée dans l’idée que celles-ci n’étaient pas des créances contre dollar, comme l’étaient les obligations, mais représentaient un droit de propriété sur des entreprises avec des capacités de production. Celles-ci, pensaient les investisseurs, devraient conserver leurs valeurs en termes réels, même si les politiciens conduisaient une politique monétaire expansionniste en dépréciant la monnaie.
Pourquoi est-il apparu qu’il n’en était pas ainsi ?
La principale raison, me semble-t-il, c’est que les actions, dans leur substance économique, sont en fait très similaires à des obligations.
Je sais que cette croyance pourra apparaître singulière pour bien des investisseurs. Ils feront observer immédiatement que le rendement d’une obligation, son coupon, est fixe, tandis que le rendement d’une action (les revenus d’une entreprise) peut varier substantiellement d’une année à l’autre. Tout à fait vrai. Mais quiconque se met à examiner les rendements en agrégat qu’ont enregistré les entreprises au cours de la période d’après-guerre découvrira quelque chose d’assez extraordinaire : les rendements des fonds propres n’ont pas vraiment beaucoup varié.
Au cours des dix premières années de l’après-guerre – la décennie allant jusqu’en 1955 – le Dow Jones Industrials a eu un rendement moyen annuel sur la valeur des capitaux propres de fin d’année des actions qui le composent, de 12,8%. Sur la seconde décennie ce rendement s’est établi à 10,1% et à 10,9% sur la troisième. Les données concernant un univers plus large d’actions, celles du Fortune 500 (dont l’historique peut remonter au milieu des années 50), révèlent des résultats à peu près similaires : 11,2% pour la décennie s’achevant en 1965, 11,8% pour celle allant jusqu’en 1975. Les chiffres pour quelques années exceptionnelles ont été substantiellement plus élevés (le maximum pour le Fortune 500 a été 14,1% en 1974) ou plus faibles (9,5% en 1958 et 1970), mais au fil des ans, et en agrégat, le rendement sur valeur comptable a eu tendance à revenir toujours autour de 12%. Nous ne décelons aucun signe laissant entrevoir un dépassement significatif de ces niveaux dans des années à forte inflation (ou d’ailleurs d’années de faible inflation).
Pour l’instant, imaginons-nous ces entreprises, non pas en tant que des actions de sociétés cotées, mais comme des entreprises productives. Émettons l’hypothèse que les propriétaires de ces entreprises les avaient acquises autour de leur valeur comptable. Dans un tel cas de figure, le rendement personnel de ceux-ci aurait été également autour de 12%. Et si leurs rendements ont été aussi réguliers, nous pourrions raisonnablement les assimiler à des « coupons sur actions ».
Dans le monde réel, bien entendu, les investisseurs sur actions ne se contentent pas d’acheter et de conserver leurs titres. Au lieu de cela, beaucoup d’entre eux essaieront de se montrer plus malins que les autres afin de maximiser la proportion des bénéfices des entreprises qui leur reviennent. Ce petit jeu destructeur, et à l’évidence complètement vain en agrégat, n’a aucun impact sur le « coupon sur action » mais a pour effet de réduire la portion qui en reviendra à l’investisseur, car ce dernier subira de substantiels coûts frictionnels, comme les frais de courtage et les coûts de conseil. Ajoutez-y un marché d’options négociables actif, qui n’ajoutera rien à la productivité de l’entreprise Amérique mais exigera le casting de milliers d’intermédiaires pour faire tourner le casino, et les coûts frictionnels augmenteront d’autant.
Il est vrai également que dans le monde réel les investisseurs en actions n’achètent pas habituellement leurs actions à leur valeur comptable. Parfois ils ont l’opportunité d’acheter au-dessous de celle-ci ; mais le plus souvent, cependant, ils ont dû payer plus que la valeur comptable, et à chaque fois que cela se produit, cela se traduit par une pression supplémentaire qui s’exerce alors sur cet objectif de 12%. Je reviendrai plus en détails sur ce relations un peu plus bas. Pour l’instant, concentrons-nous sur le point principal : alors que l’inflation a augmenté, le retour sur capital investi n’a quant à lui pas augmenté. Par essence, ceux qui achètent des actions reçoivent des titres ayant un rendement sous-jacent fixe – tout comme ceux qui achètent des obligations.
Bien entendu il existe des différences importantes entre la forme obligataire et la forme actionnariale. Pour commencer, les obligations arrivent un jour ou l’autre à échéance. Il faudra peut-être attendre longtemps, mais il y aura bien un moment où l’investisseur en obligations aura l’opportunité de renégocier son contrat. Si les taux d’inflation courants et anticipés rendent son ancien coupon inadéquat, il pourra refuser de continuer à jouer, à moins que les nouveaux coupons qui lui soient offerts rallument son intérêt. C’est un peu ce qui s’est passé ces dernières années.
Les actions, à l’opposé, sont des titres perpétuels. Ils ont une maturité infinie. Les investisseurs en actions sont bloqués par le rendement que l’entreprise Amérique pourra dégager. Si l’entreprise Amérique est destinée à gagner du 12%, c’est alors bien le taux de rendement dont doivent se satisfaire les investisseurs. En tant que groupe, les investisseurs en actions n’ont la possibilité ni de retirer leurs billes ni de renégocier leur accord. En tant qu’agrégat, leur engagement en fait ne cesse d’augmenter. Si les entreprises privées peuvent être vendues ou liquidées, et si les entreprises cotées peuvent racheter leurs actions ; en règle générale, cependant, l’émission de nouvelles actions et les bénéfices non distribués garantissent que les fonds propres bloqués dans le système augmenteront avec le temps.
Et par conséquent, c’est un point de marqué pour la formule obligataire. Les coupons obligataires seront bien amenés à être un jour ou l’autre renégociés ; les « coupons » sur les actions ne le seront pas. Il est exact, bien sûr, que pendant une très longue période un coupon de 12% n’a pas semblé avoir besoin de subir une grosse revalorisation.
Il existe une autre différence majeure entre les obligations ordinaires et notre toute nouvelle « obligation » 12% qui arrive au bal costumé de Wall Street habillée en certificat d’action.
Dans le cas habituel ; un investisseur en obligation reçoit son coupon entièrement en liquide et il lui est laissé le soin de réinvestir ces fonds du mieux qu’il puisse. Le coupon sur action de notre investisseur en actions, par contraste, est partiellement conservé par la société et réinvesti par celle-ci sur les bases du taux de retour sur capital que gagne la société. En d’autres termes, si nous retournons vers notre univers d’entreprises, une portion des 12% qui sont gagnés chaque année sera distribuée sous forme de dividendes et le solde réinvesti dans l’univers afin de continuer à gagner également du 12%.
Cette caractéristique des actions – le réinvestissement d’une partie du coupon – peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle, en fonction du degré d’attractivité relatif de ces 12%. Cette nouvelle était effectivement très bonne dabs les années 50 et au début des années 60. À une époque où les obligations ne rapportaient que du 3 ou du 4%, le droit de pouvoir investir automatiquement une portion du coupon sur actions à 12% avait beaucoup de valeur. Vous remarquerez qu’il ne suffisait pas aux investisseurs d’investir sur des actions pour s’approprier ce rendement de 12%. Les cours des actions durant cette période se sont échelonnés à des niveaux bien supérieurs à leurs valeurs comptables, et la prime à payer sur ceux-ci empêchait les investisseurs de soutirer directement de l’univers des entreprises cotées le taux de rendement sur fonds propres, quel qu’il soit, que gagnaient ces entreprises en agrégat. Vous ne pouvez pas à la fois payer beaucoup plus que le pair sur une obligation rapportant 12%, et en même temps parvenir à gagner du 12% pour vous-même.
Mais sur les bénéfices non distribués, les investisseurs pouvaient gagner du 12%. En effet, les bénéfices réinvestis permettaient aux investisseurs d’acheter pour sa valeur comptable une portion d’une entreprise qui, dabs l’environnement économique qui prévalait alors, valait bien plus que sa valeur comptable.
C’était une situation qui n’offrait pas beaucoup d’arguments à ceux qui prônaient la distribution de dividendes aux actionnaires et décourageaient fortement le réinvestissement des bénéfices. Et de fait, plus l’investisseur pensait que les chances de pouvoir réinvestir ses bénéfices à 12% étaient fortes, plus il accordait de la valeur à ce privilège de réinvestissement, et plus il était prêt à payer pour cela. Au début des années 60, les investisseurs s’empressaient de payer des prix élevés pour les compagnies de distribution électrique qui étaient localisées dans des zones à forte croissance, car ils savaient que ces entreprises avaient la capacité de réinvestir une très grande portion de leurs bénéfices. Par contre, les utilités qui opéraient dans des environnements moins porteurs, ce qui leur dictaient de plus lourdes distributions de dividendes, s’échangeaient à des cours inférieurs.
Si, durant toute cette période, une obligation à long terme de première qualité sans clause de remboursement anticipé et dotée d’un coupon à 12% avait existé, celle-ci se serait échangée à un cours bien supérieur à sa valeur nominale. Et si nous avions à faire à une obligation dotée d’une autre caractéristique inhabituelle – à savoir que le plus gros des paiements de coupon pouvait être réinvesti sur des obligations similaires à leur valeur nominale – cette émission se serait vendue avec une plus grande prime encore. Par essence même, les valeurs de croissance qui réinvestissaient le gros de leurs profits représentaient exactement de tels titres. Quand leur taux de réinvestissement sur le capital réinvesti se montait à 12%, alors que les taux d’intérêt étaient en règle générale autour de 4%, les investisseurs étaient aux anges – et, bien entendu, ils étaient prêts à payer chèrement ce privilège.
Si on regarde en arrière, les investisseurs peuvent se rendre compte que pendant la période allant de 1946 à 1966, ils se sont fait servir une généreuse triple rémunération. D’abord ils étaient bénéficiaires d’un retour sur capitaux propres sur l’entreprise sous-jacente bien supérieur aux taux d’intérêt qui prévalaient. Deuxièmement, une portion significative de ce rendement était réinvestie pour eux à des taux qui autrement leur auraient été inaccessibles. Et troisièmement, ils bénéficiaient d’un processus de réévaluation de leurs capitaux propres sous-jacents à la hausse au fur et à mesure que leurs deux premiers avantages devenaient largement reconnus. Cette troisième « couche » voulait dire que, en plus des 12% de base gagnés par les entreprises sur leurs capitaux propres, les investisseurs recevaient un bonus supplémentaire du fait que le Dow Jones Industrials était passé de 1,33 fois (133%) la valeur comptable des actions le composant en 1946 à 2,20 fois (220%) en 1966. Un tel processus de réappréciation a temporairement permis aux investisseurs d’atteindre un rendement qui dépassait la capacité à générer des bénéfices des entreprises dans lesquelles ils avaient investi.
Cette situation paradisiaque s’est finalement révélée à toutes les principales institutions financières au milieu des années 60. Mais juste au moment où tous ces éléphants de la finance ont commencé à se piétiner, en se ruant tous en même temps sur les marchés d’actions, nous sommes entrés dans une ère nouvelle caractérisée par une accélération de l’inflation et des taux d’intérêt. Et c’est fort logiquement que le niveau antérieur de réappréciation a commencé à s’inverser. La remontée des taux d’intérêt a impitoyablement réduit la valeur de tous les placements à taux fixes. Et à partir du moment où les taux des obligations d’entreprises ont commencé à grimper (pour parvenir à atteindre au bout du compte la zone des 10%), à la fois le rendement sur capitaux propres de 12% et le « privilège » de réinvestissement n’eurent d’un coup plus du tout la même allure.
Les actions sont à juste titre considérées comme étant pus risquées que les obligations. Tandis que ce « coupon sur action » est plus ou moins fixe sur de longues périodes, il fluctue cependant plus ou moins d’une année sur l’autre. Les attitudes des investisseurs au sujet du futur peuvent être affectées substantiellement, quoique fréquemment de façon erronée, par ces évolutions annuelles. L’es actions sont également plus risquées car elles sont bâties sur des maturités infinies. (Même votre amical courtier n’aurait pas l’audace de vous vendre des obligations à 100 ans, à supposer qu’il en ait, comme si c’était un produit sans risque). À cause de ce risque supplémentaire, la réaction naturelle des investisseurs c’est de s’attendre à ce qu’un rendement sur action soit confortablement au-dessus du rendement servi sur les obligations – et un rendement de 12% sur action par rapport à, disons, 10% sur obligations émises par le même univers donné d’entreprises ne me semble pas pouvoir être qualifié de « confortable ». À mesure que l’écart se réduit, les investisseurs sur actions commencent à quitter le navire.
Mais bien entendu, ils ne peuvent pas tous s’enfuir en tant que groupe. Tout ce qu’ils peuvent provoquer c’est beaucoup de mouvement, de substantiels coûts de friction, et une nouvelle valorisation, bien plus faible, qui reflètera l’attraction réduite qu’aura à leurs yeux une coupon sur actions de 12% dans des conditions inflationnistes. Les investisseurs sur obligations ont eu à subir une succession de chocs au cours de la dernière décennie, alors qu’ils découvraient dans la douleur qu’il n’y a aucune magie attachée à un niveau de coupon, quel qu’il soit. Que ce soit à 6%, 8% ou 10%, les obligations peuvent voir leur prix s’effondrer. Les investisseurs sur actions qui ne savent généralement pas qu’ils ont également un « coupon », reçoivent encore la leçon des marchés sur ce point.
Mais devons-nous vraiment penser qu’un coupon sur actions de 12% est immuable ? Existe-t-il une loi qui édicterait que les rendements des entreprises sur leurs capitaux propres ne puissent pas s’ajuster à la hausse en réponse à un taux d’inflation moyen qui de manière permanente serait orienté à la hausse ?
Bien entendu, il n’y a aucune telle loi. Mais d’un autre côté, l’entreprise Amérique ne peut pas non plus accroître ses bénéfices par envie ou par décret. Pour remonter leur retour sur capitaux propres, les entreprises auraient besoin de l’une des situations suivantes : (1) une accélération de leur cycle de rotation ; i.e., du ration entre les ventes totales et le total des actifs employés dans leur activité ; (2) une baisse du coût de leur endettement ; (3) un plus large appel à l’endettement ; (4) des impôts sur les revenus plus faibles ; (5) de plus grandes marges opérationnelles sur les ventes.
Et c’est à peu près tout. Il n’y a apparemment aucun autre moyen d’augmenter son rendement sur capitaux propres. Voyons quelle est notre marge de manœuvre sur ces leviers.
Nous allons commencer avec le taux de rotation. Les trois principales catégories d’actifs sur lesquelles nous devons nous pencher pour cet exercice sont le compte d’effets à recevoir, les stocks et les actifs immobilisés comme les usines et les machines.
Les effets à recevoir augmentent proportionnellement à l’augmentation d’es ventes, que la hausse des ventes en dollars soit produite par une hausse des volumes ou par l’inflation. Il n’y a ici aucune marge pour s’améliorer.
Pour ce qui est des stocks, la situation n’est pas aussi simple. Sur le long terme, la tendance sur la valeur des stocks en unités stockées est supposée suivre la tendance en unités vendues. Par contre, sur le court terme, le taux physique de rotation des stocks pourrait osciller à cause d’influences spéciales comme par exemple les attentes d’évolution des coûts, ou des goulets d’étranglement.
L’usage de méthodes de valorisation des stocks de type last in first out (LIFO) permet d’augmenter les taux de rotation enregistrés pendant les époques d’inflation. Quand les ventes en dollars augmentent à cause de l’inflation, la valorisation des stocks de l’entreprise qui utilisent le LIFO va soit se maintenir au même niveau (si le nombre d’unités vendues n’augmente pas) soit avoir un retard sur la hausse des ventes en dollars (si les ventes unitaires augmentent). Dans les deux cas, le volume des ventes en dollar va augmenter.
Au début des années 70, les entreprises se sont fortement orientées vers une comptabilisation des stocks suivant la méthode du LIFO (qui a pour effet d’abaisser les bénéfices reportés par l’entreprise et leur facture fiscale). La tendance semble maintenant s’être ralentie. Cependant, l’existence de nombreuses entreprises évaluant leurs stocks en LIFO, ainsi que la possibilité d’en voir un certain nombre d’autres rejoindre leurs rangs, assure que nous verrons un nouvel accroissement du taux de rotation des stocks enregistrés.
Dans le cas des actifs immobilisés, toute hausse du taux d’inflation, en faisant l’hypothèse qu’il impacte tous les produits de la même manière, aura pour effet initial d’augmenter le taux de rotations des immobilisations. Ceci s’avère exact puisque les ventes vont immédiatement refléter les nouveaux niveaux de prix, alors que les comptes d’actifs immobilisés ne reflèteront ces changements que progressivement, i.e. à mesure que les immobilisations existantes sont retirées et remplacées avec de nouveaux niveaux de prix. À l’évidence, plus l’entreprise sera lente à remplacer ses actifs immobilisés, et plus leur taux de rotation va augmenter. Cette action s’arrêtera seulement une fois le cycle de remplacement terminé. Si nous faisons l’hypothèse d’un taux d’inflation constant, les ventes et les actifs immobilisés vont commencer à monter de concert avec le taux d’inflation.
Pour résumer, l’inflation va déboucher sur quelques gains au niveau des différents ratios de taux de rotation des actifs. Quelques améliorations seront certaines grâce à l’usage du LIFO, alors que d’autre seront rendues possibles (si l’inflation s’accélère) grâce au fait que les ventes vont augmenter plus vite que les actifs immobilisés. Mais ces gains ont toutes les chances d’être modestes et pas d’une magnitude suffisante pour produire de substantielles améliorations sur les taux de retour sur capital. Au cours de la décennie qui s’est terminée en 1975, en dépit d’une inflation généralement en hausse et du large usage de la méthode LIFO, le taux de rotation des actifs (ventes nettes / total actif) des valeurs composant le Fortune 500 est seulement passé de 1,18/1 à 1,29/1.
Un effet de levier moins cher ? C’est peu probable. En général, des taux d’inflation élevés font que le coût de l’endettement augmente et pas l’inverse. Une inflation galopante provoque un besoin en capitaux qui augmente également ; et les créanciers, à mesure qu’ils perdent confiance dans les contrats de prêts à long terme, deviennent encore plus exigeants. Mais même dans le cas où la hausse des taux d’intérêts est jugulée, le coût de l’effet de levier continuera à augmenter car le coût moyen de la dette supportée maintenant par les bilans des entreprises est inférieur à ce que cela coûtera de la remplacer. Et le renouvellement de la dette sera bien sûr exigé à mesure que la dette existante arrivera à maturité. Donc dans l’ensemble la modification à venir du coût de l’effet de levier aura probablement un léger effet net dépressif sur le retour sur fonds propres.
Plus d’effet de levier ? L’entreprise Amérique a fait feu de beaucoup, sinon de la plupart, des armes lui ayant permis de doper son effet de levier. La preuve peut être trouvée dans un certain nombre de statistiques financières sur les Fortune 500. Au cours des 20 années allant jusqu’en 1975, les capitaux propres en pourcentage de la totalité des actifs ont décliné sur le Fortune 500, passant de 63% à un peu moins de 50%. En d’autres termes, chaque dollar de capitaux propres a un plus lourd effet de levier aujourd’hui que jusqu’alors.
L’ironie des exigences comptables induites par l’inflation c’est que les entreprises hautement rentables – représentant en règle générale le meilleur risque de crédit – n’ont pas besoin de proportionnellement beaucoup d’endettement. Par contre, celles qui sont en retard en termes de rentabilité en ont toujours besoin de plus. Les emprunteurs comprennent ce problème aujourd’hui beaucoup mieux qu’il y a une dizaine d’années – et sont d’autant moins enclins à permettre aux entreprises en quête de fonds et à faible profitabilité de faire un usage démesuré de l’effet de levier.
Néanmoins, et étant données les conditions inflationnistes que nous connaissons, de nombreuses sociétés sont assurées d’avoir dans l’avenir à faire appel à de plus en plus d’effet de levier afin de doper la rentabilités de leurs capitaux propres. Leurs équipes de management vont rechercher cette politique parce qu’ils auront besoin d’avoir accès à d’énormes montants de capitaux – souvent pour simplement conserver le même volume physique d’activité – et vont préférer avoir accès à des capitaux extérieurs plutôt que d’avoir à abaisser les dividendes ou faire appel à des émissions d’actions, qui à cause de l’inflation ont toutes les chances de ne pas être bien reçues. Leur réponse naturelle, ce sera de s’endetter jusqu’au cou, et à n’importe quel coût. Elles auront tendance à se comporter comme ces entreprises de distribution d’électricité qui, dans les années 60, discutaient de la moindre économie à n’en plus finir sur un point de base en plus ou en moins et qui pourtant en 1974 se trouvaient bien heureuses de trouver des gens qui acceptaient des financements à 12%.
Ajouter de la dette à des taux accessibles comme ceux d’aujourd’hui n’a cependant pas autant d’impact, en termes de rendement sur capitaux propres, que les dettes nouvelles négociées à 4% dans les années 60. Il y a de plus le problème que des ratios d’endettement en hausse provoquent une détérioration de la notation du crédit, ce qui entraîne une hausse supplémentaire des coûts de l’endettement.
C’est donc là une autre façon, à rajouter à toues celles que nous avons précédemment vues, par laquelle le coût de l’endettement va augmenter. Finalement, le coût plus élevé de l’effet de levier va probablement annihiler les mérites que l’on tire d’un plus fort endettement.
De plus il y a dès à présent bien plus de dettes sur les bilans des entreprises américaines que ne le suggère la lecture de leurs bilans. De nombreuses sociétés ont des obligations massives de financement de leurs engagements sur leurs fonds de retraite salariale, et ce quels que soient les niveaux de salaire moyens de leurs employés quand ils prendront leurs retraites. Si nous prenons les taux d’inflation moyens que nous avons connus sur la période 1955-1965, les engagements de retraites émanant de tels plans étaient raisonnablement prévisibles. Aujourd’hui plus personne ne peut s’aventurer à dire quel sera le volume d’engagement pour l’entreprise à échéance. Mais si le taux d’inflation oscille en moyenne autour de 7% dans le futur, un salarié de vingt-quatre ans qui gagne aujourd’hui 12 000 $ et dont la hausse du salaire ne devrait pas dépasser la hausse du coût de la vie, gagnera 180 000 $ quand il partira à la retraite à soixante-cinq ans.
Bien entendu vous trouverez un chiffre merveilleusement précis sur de nombreux rapports annuels chaque année, prétendant représenter l’ensemble des engagements de retraite non financés. Si ce chiffre pouvait être pris au sérieux, il suffirait à l’entreprise de débourser cette somme, l’ajouter aux actifs existant du fonds de pension, confier ensuite la gestion de ce capital à une société d’assurance et lui donner ensuite la responsabilité de couvrir tous les engagements de l’entreprise pour ses pensionnés. Malheureusement il est hélas impossible dans le monde réel de trouver une compagnie d’assurance qui n’accepte ne serait-ce que de discuter d’une telle idée.
Pratiquement tous les trésoriers d’entreprises d’Amérique s’en iraient en courant à l’idée d’émettre une obligation indexée sur le « coût de la vie » – une obligation non rachetable dont les coupons seraient liés à un indice des prix. Pourtant avec le système de pension privé qu’elles ont mis en place, les entreprises américaines dans leur ensemble ont en fait assumé un montant invraisemblable de dette qui est pourtant l’équivalent d’une telle obligation.
Utiliser plus d’effet de levier, soit au moyen de l’endettement conventionnel soit sous la forme d’une dette correspondant aux engagements de financement des retraites des salariés qui apparaissent dans l’hors-bilan, devrait être pris avec scepticisme par les actionnaires. Un retour sur capital de 12% pour une entreprise qui n’a aucun endettement, cela n’a rien à voir avec un même retour sur capital pour une société endettée jusqu’au cou. Cela veut dire qu’un rendement de 12% obtenu aujourd’hui a beaucoup moins de valeur que le rendement de 12% d’il y a vingt ans.
Une baisse des taux d’imposition des bénéfices des entreprises paraît peu probable. Les actionnaires ordinaires des sociétés américaines détiennent ce qui pourrait être assimilé à des actions de classe D. Les actions de classe A, B et C sont représentées par les charges d’impôt sur les revenus anticipés respectivement prélevées par les autorités Fédérales, les autorités des États et par les administrations Municipales. Il est exact que ces trois classes d’« investisseurs » n’ont aucun droit sur les actifs de l’entreprise ; cependant ils reçoivent une part majeure des bénéfices, y inclus les bénéfices générés par l’accumulation d’avoirs résultant de la non-distribution d’une partie des bénéfices appartenant aux actionnaires de classe D.
Une nouvelle caractéristique charmante de ces actions de classe A, B et C c’est que la portion des bénéfices de l’entreprise à laquelle ils prétendent peut être accrue à tout instant, dans une large proportion, par simple vote unilatéral des actionnaires, autrement dit par le Congrès des États-Unis pour les actionnaires de Classe A. Pour ajouter au plaisir, l’une de ces classes d’actionnaires privilégiés pourra parfois voter pour accroître ses parts de propriété dans l’entreprise et ceci de façon rétroactive – comme les entreprises domiciliées dans l’État de New-York en ont fait l’amère expérience en 1975. Chaque fois que les actionnaires des classes A, B et C s’approprient par leur vote une plus grande portion d’une affaire, la part qui reste aux actionnaires de la classe D – autrement dit celle qui revient aux actionnaires ordinaires – baisse d’autant.
Si l’on se projette dans l’avenir, il pourrait être imprudent d’admettre que ceux qui contrôlent les actions A, B et C vont voter pour réduire leurs allocations à long terme. Les actions de la classe D auront probablement à se battre si leurs actionnaires veulent conserver leur part.
La dernière de nos cinq sources possibles d’une augmentation du rendement des capitaux propres d’une entreprise ce serait de s’arroger des marges d’exploitation plus importantes sur les ventes. C’est ici que quelques optimistes voudraient espérer obtenir des gains majeurs. Il n’est pas possible de prouver qu’ils aient tort. Mais il n’y a jamais plus que 100 cents par dollar de vente et beaucoup d’exigences portent sur ce dollar avant que l’on en arrive aux profits résiduels avant impôts. Les principaux demandeurs sont les salaires, les matières premières, l’énergie, et divers impôts en plus de l’impôt sur les sociétés. L’importance relative de ces coûts a peu de chances de baisser à une époque d’inflation.
Qui plus est, quelques preuves statistiques récentes ne font rien pour redonner confiance à cette idée que les marges vont augmenter dans le cadre d’une période d’inflation. Sur la décennie qui s’est terminée en 1965, une période d’inflation relativement faible, l’univers des entreprises manufacturières dont les statistiques financières sont reportées trimestriellement par la Federal Trade Commission a eu des bénéfices moyens avant impôts sur les ventes de 8,6%. Sur la décennie terminée en 1975, la marge moyenne a été de 8%. Les marges se sont donc affichées à la baisse en dépit de la hausse considérable du taux d’inflation.
Si les entreprises étaient capables de baser leurs prix en fonction de leurs coûts de remplacement, les marges devraient alors s’élargir durant des périodes inflationnistes. Mais la simple vérité c’est que la plupart des grosses affaires, en dépit d’une opinion largement répandue sur leur force commerciale, ne parviennent tout simplement pas à tirer leur épingle du jeu dans ce domaine. Une comptabilité basée sur les coûts de remplacement montre dans la grande majorité des cas que les bénéfices des entreprises ont décliné de façon significative au cours des dix dernières années. Si des industries aussi essentielles que l’énergie, l’acier et l’aluminium ont définitivement le muscle oligopolistique qui leur est accordé, alors nous ne pouvons qu’en conclure que leurs politiques des prix ont été remarquablement mesurées.
Voilà, nous avons passé en revue la ligne de départ avec les cinq facteurs qui peuvent améliorer les rendements des capitaux propres, et aucun d’eux, d’après mon analyse, n’a beaucoup de chances de nous amener bien loin dans cette direction dans les périodes à forte inflation. Peut-être sortez-vous de cet exercice plus optimiste que je ne le suis. Mais rappelez-vous bien d’une chose, ces rendements autour de la zone des 12% ont été avec nous depuis longtemps.
Même si vous cautionnez l’idée que ce coupon sur action de 12% est plus ou moins immuable, il est possible que vous espériez bien vous en sortir avec cela dans les années à venir. Et il n’est pas inconcevable que vous y parveniez. Après tout, un grand nombre d’investisseurs s’en sont bien tirés avec depuis pas mal de temps. Mais vos rendements futurs vont être gouvernés par trois variables : la relation entre la valeur comptable et la valeur marché de l’entreprise, le taux d’imposition et le taux d’inflation. Ingurgitons un peu de calcul au sujet de la relation entre valeur comptable et valeur marché. Quand les actions se vendent avec constance à un prix autour de leur valeur comptable, alors tout est beaucoup plus simple. Si une action a une valeur comptable de 100$ ainsi qu’un cours en moyenne égal à 100$, les revenus de 12% dégagés par le business vont générer un retour sur investissement de 12% pour l’investisseur (moins les coûts frictionnels que nous ignorerons pour le moment). Si el taux de distribution est de 50%, notre investisseur touchera 6$ sous forme de dividendes et 6$de plus sous forme d’un accroissement de la valeur comptable de l’affaire, qui, bien entendu, sera reflétée dans les cours des actions détenues.
Si l’action se vendait à 150% de sa valeur comptable, le schéma serait complètement différent. L’investisseur recevrait ces même 6$ de dividendes en liquide, mais ceux-ci ne représenteraient maintenant plus que 4% de rendement pour un investissement de 150$. La valeur comptable de l’affaire augmenterait toujours de 6% (à 106$) et la valeur marché des actions détenues par l’investisseur, à supposer qu’elles soient valorisées avec constance sur les bases de 150% de leur valeur comptable, devrait donc augmenter à l’identique de 6% (à 159$). Mais le rendement total pour l’investisseur, tiré de l’appréciation de l’action et des dividendes, ne serait plus que de 10% contre les 12% sous-jacents gagnés par la société.
Quand l’investisseur achètera l’action au-dessous de sa valeur comptable, le processus sera inversé. Par exemple, si l’action s’échange à 80% de sa valeur comptable, les mêmes hypothèses en termes de bénéfices et de taux de distribution, rapporterait 7,5% sous forme de dividendes (6$ sur un pris de 80$) et 6% sous forme de plus-value sur l’action – pour un rendement total de 13,5%. En d’autres termes, vous vous en tirez mieux si vous achetez vos actions avec un discount plutôt qu’un premium sur leur valeur comptable, ce que vous suggère d’ailleurs le simple bon sens.
Au cours des années d’après-guerre, la valeur boursière du Dow Jones Industrials a fluctué entre une borne basse située à 84% de sa valeur comptable (en 1974) et une borne haute à 232% de celle-ci (en 1965) ; la plupart du temps le ratio a été largement au-dessus de 100. (Au début du printemps, ce ratio se situait autour de 110%). Faisons l’hypothèse que dans l’avenir le ratio sera plus proche de 100%, ce qui revient à dire que les investisseurs en actions pourraient gagner la totalité des ces 12%. Ou du moins, ils pourraient gagner cela avant impôts et avant inflation.
Quelle portion de ces gains de 12% pourrait représenter l’impôt ? Pour les investisseurs particuliers, il semble raisonnable de penser que les impôts sur les revenus prélevés au niveau Fédéral, à celui de l’État et au niveau local devraient en moyenne représenter environ 50% sur les dividendes et 30% sur les plus-values du capital. Une majorité d’investisseurs aura probablement des taux marginaux quelque peu inférieurs à ceux-ci, mais nombre de ceux qui détiennent de plus lourds patrimoines seront soumis à des taux substantiellement plus forts. Selon la nouvelle loi fiscale, un investisseur à revenus élevés habitant dans un communauté à forts impôts pourrait se retrouver avec un taux de taxation marginal qui pourrait atteindre les 56%.
Donc, utilisons les taux de 50% et 30% comme représentatifs de l’imposition des investisseurs particuliers.
Supposons également, ce qui est en ligne avec notre expérience récente, que les sociétés qui gagnent 12% sur leurs capitaux propres en distribuent 5% sous forme de dividendes en liquide (2,5% après impôts) et en retiennent 7%, en admettant que ces bénéfices non distribués vont provoquer une croissance des cours proportionnelle (soit 4,9% après 30% de taxes). Le rendement après taxes serait donc alors de 7,4%. Nous devrions probablement arrondir ce chiffre à 7% pour tenir compte des divers coûts frictionnels. Pour pousser d’un cran notre thèse où nous assimilons des actions à des obligations, alors, ces actions devraient être considérées pour les individus comme l’équivalent d’obligations perpétuelles à 7% sans taxes.
Ce qui nous mène à une question cruciale, qu’en est-il du taux d’inflation ? Nul ne connaît la réponse là-dessus, pas plus d’ailleurs les politiciens, les économistes et autres experts en investissement, ceux-là même qui avaient pensé il y a quelques années qu’avec quelques légers coups de pouce par-ci ou par-là, les taux d’inflation et le chômage répondraient aux impulsions politiques comme des phoques de cirque.
Mais de nombreux signes paraissent négatifs pour ce qui est de la stabilité des prix : le fait que nous retrouvions maintenant de l’inflation partout dans le monde ; la propension des principaux groupes de pressions dans nos sociétés à utiliser leur muscle électoral pour déplacer plutôt que pour résoudre les problèmes économiques ; le manque évident de bonne volonté pour s’attaquer aux problèmes les plus vitaux (e.g., à celui de l’énergie et à celui de la prolifération nucléaire) s’ils peuvent être remis à plus tard ; et un système politique qui récompense le législateur par une réélection si son action semble produire des bienfaits à court terme et ce quand bien même leur empreinte ultime sera d’aggraver le mal à long terme.
La plupart de ceux qui détiennent des postes politiques, et l’on comprend pourquoi, sont contre l’inflation mais pratiquent des politiques qui encouragent sa venue. (Cette schizophrénie n’est pas allée jusqu’à leur faire perdre contact avec la réalité ; les membres du Congrès se sont assurés de voir leurs pensions –contrairement à pratiquement toutes celles que délivre le secteur privé – être indexées sur l’augmentation du coût de la vie pour le calcul de leurs retraites.)
Toutes les discussions concernant les taux d’inflation à venir sondent les subtilités des politiques monétaires et fiscales. Ce sont là des variables importantes pour déterminer ce que donnerait toute équation spécifique sur l’inflation. Mais à sa source, l’inflation en temps de paix est un problème politique, pas un problème économique. C’est le comportement humain et pas le comportement monétaire qui est essentiel. Et lorsque des politiciens très humains ont à faire un choix entre la prochaine élection et la prochaine génération, tout le monde sait comment cela se passe d’habitude.
De telles généralisations aussi larges ne donnent pas de chiffres précis. Cependant, il paraît tout à fait possible que le taux d’inflation moyen tournera autour de 7% dans le futur. J’espère que cette prévision s’avèrera fausse. Et ce pourrait fort bien être le cas. Les prévisions en règle générale nous en disent plus sur ceux qui les font que sur le futur. Vous êtes libres d’intégrer vos propres taux d’inflation projetés dans l’équation de l’investisseur. Mais si vous anticipez un taux faisant en moyenne 2 ou 3%, c’est que vous chaussez d’autres lunettes que les miennes.
Aussi nous y voilà : 12% avant impôts et inflation ; 7% après impôts et avant inflation ; et peut-être zéro pour cent après impôts et inflation. Il est clair que cela ne semble pas être une formule qui attirera grand monde.
En tant qu’actionnaire vous allez vous retrouver avec plus de dollars mais il est possible que vous n’ayez pas plus de pouvoir d’achat. Nous revoilà fâchés avec Ben Franklin (« un penny d’épargné c’est un penny de gagné »), i.e. il est aussi utile d’épargner de l’argent que de la gagner) et réconciliés avec Milton Friedman (« Un homme a tout intérêt à consommer son capital plutôt qu’à l’investir. »)
Les calculs montrent clairement que l’inflation est un impôt beaucoup plus destructeur que tous les impôts qui ont été établis par nos politiciens. L’impôt que représente l’inflation a le talent fantastique de simplement consumer le capital. Cela revient au même pour une veuve vivant de son épargne, rémunérée à 5% sur son livret de retraite, d’avoir à payer un impôt de 100% sur les intérêts gagnés durant une période sans inflation que de ne payer aucun impôt durant une période où l’inflation est de 5%. Dans tous les cas, elle est taxée de telle manière qu’il ne lui reste aucun revenu réel en fin de compte. tout l’argent qu’elle dépense vient directement de son capital. Elle trouverait scandaleux de payer un impôt sur ses revenus de 120%, mais elle ne se rend pas compte qu’une inflation de 6% est son équivalent économique.
Si mon hypothèse sur l’inflation est proche de ce que nous réserve l’avenir, le marché boursier aura des résultats décevants non pas parce qu’il va tomber, mais plutôt en dépit du fait qu’il va monter. Oscillant autour des 920 points au début du mois passé, le Dow valait cinquante-cinq points de plus qu’une dizaine d’années plus tôt. Mais une fois ajusté pour l’inflation, le Dow marque une baisse d’environ 345 points – et est passé de 865 à 520 en termes réels. Et encore, près de la moitié des gains du Dow ont dû être non-distribués et réinvestis afin d’atteindre ce maigre résultat.
Au cours des prochaines années, le Dow devrait doubler ne serait-ce qu’en combinant ce coupon sur action de 12%, avec un ratio de distribution de 40%, et si le ratio actuel de 110% entre valeur boursière et valeur comptable des actions demeure constant. En intégrant une inflation à 7% et en respectant ce cadre, les investisseurs qui vendraient alors à 1800 seraient, tout bien comparé, dans une situation bien pire qu’ils ne le sont aujourd’hui, une fois payés leurs impôts sur les plus-values.
J’entends presque la réaction qu’auront certains investisseurs à ces pensées négatives. Il leur suffit de supposer, quelles que soient les difficultés qui nous attendent dans cette nouvelle ère pour l’investissement, qu’ils seront suffisamment malins pour trouver le moyen d’obtenir des résultats pour eux-mêmes supérieurs à ceux du groupe. Il est plus qu’improbable qu’ils réussissent dans leur entreprise. Pour l’ensemble des investisseurs, bien entendu, c’est impossible. Si vous pensez une seule seconde que vous pouvez entrer et sortir de positions sur actions avec assez d’agilité pour éviter de payer la taxe invisible de l’inflation, j’aimerais bien être votre courtier, mais certainement pas votre associé.
Même les investisseurs que l’ont appelle les exemptés de taxes, comme, par exemple, les fonds de pension et les fondations universitaires, ne peuvent échapper à la taxe de l’inflation. Si mon hypothèse d’un taux d’inflation de 7% est correcte, le trésorier d’une université devrait considérer que les premiers 7% gagnés chaque année ne font que balancer la perte du pouvoir d’achat qu’il subit sur ses rentrées. Les fondations universitaires ne gagneront en fait rien du tout avant d’avoir dépassé le taux d’inflation. Autrement dit, avec 7% d’inflation et avec un taux de rendement brut de 8%, ces institutions, qui pensent être exonérées de taxes, payent en fait une taxe de 87,5% sur leurs revenus.
Malheureusement, les principaux problèmes dus à de hauts niveaux d’inflation ne sabordent pas tant les investisseurs que la société dans son ensemble. Les revenus de l’investissement ne représentent qu’une faible portion du produit national, et si les revenus per capita pouvaient s’apprécier à un rythme soutenu en parallèle à des rendements de l’investissement qui s’approcheraient de zéro, ce ne serait pas si mal que cela en termes de justice sociale.
Une économie de marché porte en elle le risque de créer des récompenses asymétriques à ses différentes classes de participants. Le patrimoine génétique, comme par exemple la bonne dotation en termes de cordes vocales supérieures, de force physique, ou de capacités intellectuelles, peut produire une montagne d’exigences financières (sous la forme d’actions, d’obligations et d’autres formes de capital) sur le produit national futur. La bonne sélection d’ancêtres peut, de même, déboucher sur une fourniture à vie de billets gagnants de même type, hérités de sa naissance. Si un rendement de zéro sur l’investissement avait pour effet de détourner une portion un peu plus grande du produit national des mains des actionnaires, cela ne devrait pas vraiment faire insulte à l’équité de ce monde au point de provoquer une intervention divine.
Mais le potentiel de gains pour une amélioration du bien-être des travailleurs aux dépens d’affluents actionnaires n’est pas significatif. La rémunération des employés totalise déjà vingt-huit fois les montants versés en dividendes, et une grande partie de ces dividendes retournent maintenant à des fonds de retraite, à des organisations à but non lucratif comme des universités, ainsi qu’à des actionnaires qui ne sont pas affluents. Dans de telles circonstances, si nous utilisions maintenant tous les dividendes destinés aux riches actionnaires pour redistribuer ces ressources sous forme de salaires – chose que nous ne pourrions faire qu’une seule fois, comme si on tuait une vache ou un cochon ; cela ne nous permettrait même pas d’augmenter les salaires en termes réels de ce que nous avions coutume d’obtenir avec l’aide de la seule croissance interne annuelle de l’économie.
Par conséquent, l’affaiblissement des riches, au travers de l’impact de l’inflation sur leurs investissements, ne fournira même pas une aide tangible à court terme à ceux qui ne le sont pas. Car le bien-être économique des masses va monter ou baisser en fonction de l’impact général qu’aura l’inflation sur l’économie. Et cet impact a peu de chances d’être positif.
Des gains importants en termes de capitaux réels, réinvestis dans des unités de production modernes, sont nécessaires pour déboucher sur des gains importants en termes de bien-être économique. Une grande disponibilité de forces vives pour le travail, de grands besoins de consommation, et de grandes promesses de l’État n’aboutiront à rien d’autre qu’à une immense frustration sans la création et l’emploi continu de nouveaux investissements productifs dans nos industries. C’est une équation qui est aussi bien comprise par les Russes que par les Rockefeller. Et c’est une équation qui a été suivie avec un extraordinaire succès par des pays comme l’Allemagne et le Japon. De forts taux d’accumulation du capital ont permis à ces pays de réaliser des gains en termes de leurs niveaux de vie dépassant largement les nôtres, bien que nous ayons joui d’un positionnement bien supérieur au leur en termes d’accès à l’énergie.
Pour comprendre l’impact de l’inflation au niveau de l’accumulation de capital en termes réels, il faut faire un peu de mathématiques. Revenons un instant à ces 12% de rendement sur les fonds propres des entreprises. De tels bénéfices sont entendus après amortissements, soit des provisions sur des dépenses qui sont supposées permettre le remplacement des capacités de production, mais ceci à condition que cette usine ou cet équipement nécessaire puissent être achetés dans le futur à des prix similaires à leurs coûts originaux.
Faisons l’hypothèse qu’autour de 50% des bénéfices sont distribués sous forme de dividendes, ce qui laisse 6% de fonds propres disponibles pour financer la croissance future. Si l’inflation est basse – disons 2% – une grande proportion de cette croissance pourra être de la croissance réelle se traduisant par des productions physiques. Car dans de telles circonstances, 2% supplémentaires devront être investis pour le financement des comptes clients, des stocks et des actifs immobilisés l’an prochain, et ce seulement pour pouvoir dupliquer la production physique de cette année – ce qui laisse donc 4% pour l’investissement dans des actifs destinés à produire plus de biens physiques. Les premiers 2% financent une croissance illusoire des dollars en circulation reflétant l’inflation et les 4% qui restent financent de la vraie croissance. Si la croissance de la population est de 1%, les 4% de gains en termes de production en termes réels, se traduiront par 3% de gains en termes de revenus per capita net réels. C’est ce qui, en gros, s’est habituellement produit au niveau de notre économie.
Maintenant remontez le taux d’inflation à 7% et calculez ce qui reste pour la croissance en termes réels après le financement de la composante inflation obligatoire. La réponse c’est qu’il ne reste plus rien dans le cas où les politiques de distribution des dividendes et les ratios d’endettement restent inchangés. Une fois que la moitié des 12% de profits est distribuée, il reste toujours ces mêmes 6%, mais ceux-ci sont entièrement mobilisés pour fournir les dollars supplémentaires nécessaires à financer le même volume physique de transactions que l’an dernier.
De nombreuses entreprises, qui se trouvent confrontées à une absence de bénéfices non distribués destinés à financer une expansion physique après distribution normale des dividendes, vont se mettre à improviser. Comment, se demanderont-elles, pouvons-nous limiter ou arrêter la distribution de dividendes sans risquer la colère des actionnaires ? J’ai de bonnes nouvelles pour eux : une série de recettes prêtes à l’emploi est disponible.
Ces dernières années, les sociétés de distribution électrique n’avaient pas ou peu de capacités de distribution des dividendes. Ou plutôt, elles auraient eu le pouvoir de payer des dividendes si les investisseurs avaient accepté de leur acheter des actions nouvelles. En 1975 les sociétés de distribution d’électricité ont payé un montant global de dividendes se montant à 3,3 milliards de dollars et ont demandé à leurs investisseurs de leur en retourner 3,4 milliards. Bien sûr ils ont ajouté une petite dose du type « je sollicite Pierre pour payer Paul » afin de ne pas terminer avec une réputation aussi épouvantable que Continental Edison. Con Ed, vous vous en souvenez, commit la folie en 1974 d’annoncer simplement à ses actionnaires qu’ils n’avaient pas assez d’argent pour payer leurs dividendes. Une telle candeur fut récompensée par un désastre sur le marché boursier.
La compagnie d’électricité plus intelligente maintient – augmente même peut-être – ses dividendes trimestriels puis demande à ses actionnaires (les anciens et les plus récents) de lui renvoyer l’argent distribué. En d’autres termes, l’entreprise émet des actions nouvelles. Cette procédure détourne d’énormes montants de capitaux vers le collecteur d’impôts ainsi que des sommes substantielles vers les banques émettrices. Et cependant tout le monde garde sa bonne humeur (et plus particulièrement les émetteurs).
Encouragées par de tels succès, certaines compagnies électriques ont mis au point un raccourci plus rapide encore. Dans ce scenario, l’entreprise annonce un dividende, les actionnaires paient des impôts dessus et illico-presto de nouvelles actions sont émises. Aucun argent ne change de main, ce qui n’empêche pas les services fiscaux, aussi rabat-joie qu’à leur habitude, de s’obstiner à considérer la transaction comme si elle avait eu lieu effectivement.
AT&T, par exemple, a institué son programme de réinvestissement des dividendes en actions en 1973. Cette entreprise, en toute impartialité, se doit d’être décrite comme très soucieuse des intérêts de ses actionnaires, et son adoption de ce type de programme, eu égard aux usages populaires de la finance, doit être considérée comme tout à fait compréhensible. Mais la substance de ce programme a tiré des pages provenant tout droit d’Alice au pays des merveilles.
En 1976, AT&T a payé 2,3 milliards de dollars de dividendes en cash à quelques 2,9 millions d’actionnaires historiques. À la fin de l’année, 648 000 d’entre eux (contre seulement 601 000 l’année précédente) ont réinvesti 432 millions de dollar (contre seulement 327 millions l’année précédente) en actions nouvelles que l’entreprise leur a directement distribuées.
Juste pour s’amuser, imaginons que finalement tous les actionnaires d’AT&T signent pour ce programme. Dans ce cadre-là, aucun chèque n’aura à être envoyé par courrier aux actionnaires, pour un résultat identique à ce que fit Continental Edison quand ils ont supprimé toute distribution de dividendes. Cependant, chacun de ces 2,9 millions d’actionnaires aura été averti qu’il devra payer des impôts sur les revenus sur les bénéfices non répartis qui avaient cette année-là été considérés comme des « dividendes ». Si nous faisons l’hypothèse que les « dividendes » ont représenté un total de 2,3 milliards de dollars, chiffres de 1976, et que les actionnaires étaient imposés dessus au taux moyen marginal de 30%, cela aboutirait, tout cela grâce à ce plan merveilleux, à payer gracieusement 700 millions de dollars aux autorités fiscales. Imaginez un instant quelle aurait alors été la joie des actionnaires, eu égard aux circonstances, si les directeurs en étaient venus alors à doubler les dividendes.
Nous pouvons nous attendre à voir encore plus de ces méthodes dissimulant des réductions de paiements aux actionnaires alors que les sociétés se battent avec le problème de la croissance des capitaux propres en termes réels. Mais ce n’est pas en étranglant les actionnaires de cette manière que le problème pourra être entièrement évacué. Cette combinaison de 7% d’inflation associée à 12% de rendement ne pourra que réduire les flux de capitaux d’entreprises disponibles pour financer la vraie croissance.
Et donc, tandis que les méthodes traditionnelles destinées à accumuler des capitaux s’affaiblissent en période d’inflation, les autorités vont de plus en plus tenter d’orienter les flux de capitaux vers l’industrie, parfois elles y parviendront comme au Japon, d’autres fois elles échoueront comme en Angleterre. Les indispensables fondements culturels et historiques qui sous-tendent un partenariat harmonieux entre les autorités et les entreprises au Japon semblent bien manquer ici. Si nous avons de la chance, nous pourrons éviter la voie choisie par l’Angleterre, où tous les segments de la société s’entre-déchirent pour un partage du gâteau qui leur soit favorable plutôt que d’unir leurs énergies pour accroître ce gâteau.
L’un dans l’autre, il est cependant très vraisemblable que nous entendrons parler de plus en plus avec le temps des problèmes de sous-investissement, de stagflation, et de l’échec du secteur privé à résoudre les problèmes auxquels il se trouve confronté.