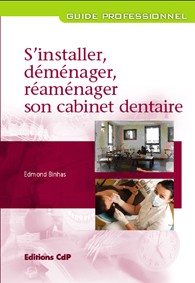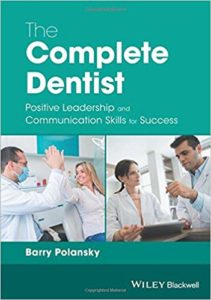[ddownload id= »1691″]
Le texte qui suit s’adapte librement des textes et de la trame de l’ouvrage « S’installer, déménager, réaménager son cabinet dentaire », paru en 2011 aux Éditions CdP dans la collection « Guide Professionnel » (Auteurs : Edmond Binhas, Yannick Harel, Délia Rahal, Sylvie Ratier, Marc Sabek – Préface de Patrick Missaka).
INTRODUCTION
« La première installation est une véritable aventure. Elle comporte un grand nombre de paramètres et chacun d’eux peut s’avérer déterminant pour le succès ou l’échec. Il est donc prudent de les analyser sérieusement avant de prendre sa décision. ».
Extrait tiré de la préface de l’ouvrage « S’installer, déménager, réaménager son cabinet dentaire » (2011, Éditions CdP), Patrick Missika, Maître de conférences des Universités, Praticien hospitalier des Hôpitaux de Paris, Professeur associé Tufts University Boston.
1- CHIRURGIEN DENTISTE : UNE PROFESSION ACTUELLE :
De nombreuses questions se posent lorsqu’un praticien souhaite s’établir en tant que chirurgien-dentiste, que la démarche soit axée vers une installation, un transfert de cabinet ou même un réaménagement. Légitimes, ces questions englobent tous les aspects, anciens et/ou actuels, de la profession. Il est important de considérer, dans cette optique, ce qu’a été l’évolution de la profession durant les dernières décennies. Un constat s’impose : le chirurgien dentiste d’aujourd’hui n’est plus seulement un clinicien. Son métier a évolué et se caractérise désormais par une grande complexité ; complexité qui entretient des doutes quant à la pérennité de la profession et la nature de ses perspectives d’avenir.
Touchant l’évolution de la profession, l’on note un net changement du panorama entre hier et aujourd’hui. Sur les plans fiscaux, pragmatiques mais également humains, être chirurgien-dentiste autrefois présentait des avantages auxquels les praticiens actuels ne peuvent plus prétendre ; concurrence faible, forte demande, profession reconnue et patients déférents, fiscalité appliquée.
À titre d’exemple, en 1995, l’on donnait, en France, entre 65 et 70 praticiens pour 40 000 à 45 000 personnes. Depuis 2005, ce chiffre accuse une baisse constante et les projections réalisées prévoient qu’il puisse se réduire à une fourchette de 40 à 45 praticiens pour le même taux de population. En somme, le nombre de diplômés aujourd’hui ne suffit plus à combler l’écart creusé par les départs en retraite.
Les analyses démontrent que deux facteurs, principalement, sont à l’origine de ce pourcentage en dents de scie :
-« Le vieillissement des effectifs », constaté depuis l’application du Numerus Clausus (en 1971),
– « La féminisation de la profession », en constante augmentation. Les praticiennes n’exercent pas ou exercent moins en libéral, or, c’est à très large majorité que les chirurgiens-dentistes exercent en libéral (à 91, 5 % en 2006, en France).
Notons que la profession se caractérise par un faible taux de salariés, et que les professionnels libéraux sont, à parts à peu près égales, installés seuls ou regroupés au sein de diverses associations. Bien entendu, dans ce corps de métier comme dans bien d’autres, l’on constate des écarts de répartition en terme de densité des chirurgiens-dentistes selon que l’on se situe au nord ou au sud de la France, en zone rurale ou urbaine.
Concernant les revenus que sont amenés à dégager les chirurgiens-dentistes, et toujours prenant en compte les écarts entre les régions et les contextes d’exercice, depuis 2001 l’on observe une évidente tendance à la croissance (« Entre 1993 et 2004, les revenus libéraux des chirurgiens-dentistes ont augmenté de 1,3 % par an en moyenne »). Si les revenus sont plus élevés dans les régions moins peuplées, l’on peut toutefois dire que les revenus réels dégagés par les dentistes s’alignent sur ceux des autres pratiques de la médecine, en ce qui concerne les évolutions de croissance.
Aujourd’hui que l’on constate un manque de visibilité évident de la profession de chirurgien-dentiste, il convient de définir quels sont les problèmes que les praticiens en exercice seront amenés à rencontrer, ainsi que leur nature. Ils apparaissent de deux ordres : intrinsèques à l’activité exercée, étrangers à cette activité.
Parmi les problèmes intrinsèques, sur le plan humain, nous distinguerons la difficulté de s’ouvrir au progrès et aux changements, assortie d’une certaine appréhension, compréhensible mais qu’il s’agit de dépasser et de muer en moteur positif. S’impose également la conclusion suivante : de nos jours, se révéler excellent clinicien ne suffit plus. La qualité des soins dispensés n’est en aucune manière soumise à remise en question, quoi qu’essentielle et primordiale, du moment que le patient ne peut en juger, il convient toutefois pour le chirurgien-dentiste d’assortir ses compétences cliniques de qualités entrepreneuriales qui touchent aux domaines de la gestion et de la communication. Ainsi ses qualités de praticien seront mises en relief. « Le savoir-faire ne suffit plus, il faut également développer votre « faire-savoir ».
Quant aux problèmes étrangers à l’activité – disons, d’ordre externe – l’on en distingue quatre principaux.
• Premièrement, ce sont les évolutions constatées en termes de progrès technologiques (nombreux) et de contraintes techniques (accrues) qui posent question,
• En deuxième lieu interviennent les changements de patientèle (dues notamment à ladite « disparition des caries dentaires » constatée en Europe du nord) et les modifications des thérapeutiques (l’on assiste aujourd’hui au développement de nouveaux domaines d’intervention, citons l’implantologie et/ou l’esthétique aussi bien qu’à la modernisation des anciens).
• Par la suite, il apparaît que c’est la forme que prennent les changements technologiques qui pose problème dans la mesure où chaque modification apportée n’a plus le temps d’engendrer une véritable révolution de la profession comme c’était le cas autrefois ; le rythme et l’occurrence en étant trop soutenus.
• Enfin, en quatrième lieu, la multiplication aussi bien que la pertinence des nouvelles normes qui viennent régir la profession de chirurgien-dentiste n’en facilitent pas la pratique au quotidien ; il faut désormais penser « normes de radioprotection », « normes hygiéniques » (beaucoup plus strictes), « normes de contrôle des compresseurs », etc.
Le praticien d’aujourd’hui sera également sensibilisé aux questions d’ordre démographique et sociétal qui constituent une rupture avec les époques passées. L’émergence d’une Europe plus ouverte, par exemple, implique l’installation en territoire français de praticiens issus de divers pays de l’union. Il en résulte non seulement des écarts entre les pratiques, mais des évidences de concurrence.
De plus, sur le plan relationnel, l’on constate la modification des rapports praticien-patient. Autrefois privilégiés, ils semblent être aujourd’hui régis par des considérations plus matérielles qui signifient cependant une plus grande implication des patients dans les questions qui les regardent. L’on peut dire que le « patient » est devenu « consommateur ». C’est ce que le praticien devra découvrir et ne pas oublier, avec tout ce que cela implique ; notamment, que le patient peut être amené à changer de praticien si les services dispensés, pour une raison ou pour une autre, ne lui conviennent guère.
Avec le recul accusé par la sécurité sociale en terme de remboursement des frais de soins dentaires et l’augmentation des parts des mutuelles, l’avenir de la profession se dessine pluriel. Attendu que plusieurs systèmes de santé seront référents dans le futur, il convient de parier sur une parfaite organisation qui se devra de compléter l’excellence des soins dispensés, et une évaluation appropriée des honoraires, cela si les praticiens souhaitent ne pas se trouver pris dans la spirale des remboursements de la Sécurité sociale. C’est sans nul doute la qualité d’une réputation transmise par le bouche-à-oreille qui assurera la pérennité des cabinets de demain, alliée à la compréhension des nouvelles tendances qui prêtent à l’hygiène et à la santé des critères d’esthétique qui modifient le visage de la profession de chirurgien-dentiste.
2- LES PRINCIPES DÉONTOLOGIQUES ET ÉTHIQUES ; LA FORMATION CONTINUE :
Il convient naturellement d’aborder les questions de la déontologie, de l’éthique, et de la formation continue des chirurgiens-dentistes dans une optique d’épanouissement des praticiens et de bien-être des patients.
Bien entendu, il existe des règles et tout un ensemble de recommandations qui régissent la profession de chirurgien-dentiste. Ces obligations s’expriment en termes de droits autant que de devoirs. En France, la profession, depuis 1945, est représentée par l’ONCD (Ordre National des Chirurgiens Dentistes), lequel, organisme privé de personnalité morale, chargé des missions d’ordres réglementaire, administratif et juridictionnel, regroupe tous les chirurgiens-dentistes qui exercent sur le territoire français quel que soit le mode d’exercice pour lequel ils ont opté. L’ONCD veille sur le code de déontologie, à son respect mais aussi à ses évolutions et privilégie « en toute circonstance le respect et l’intérêt du patient ».
À ce sujet, plusieurs points sont pris en considération, les uns concernant strictement la profession et sa pratique (compétences avérées, qualité des soins, respect du secret professionnel, clarté et fluidité des échanges praticien-patient), les autres touchant des critères plus généraux et pragmatiques (évidence du libre-choix, devoir d’entretenir ses connaissances professionnelles au meilleur niveau, etc.).
Un fait important : le Code de déontologie des chirurgiens-dentistes prescrit des obligations précises en terme de confraternité, obligations auxquelles il conviendra de se soumettre durant toute la durée d’exercice de la profession, mais auxquelles il sera bon de porter intérêt également au moment de considérer une installation. par exemple en s’assurant de rendre visite aux chirurgiens-dentistes qui exercent dans la localité concernée.
La lecture des articles traitant de ces obligations est primordiale afin de bien comprendre quels rapports sont attendus entre les confrères chirurgiens-dentistes. La convivialité, le soutien moral, l’interdiction des médisances s’appliquent en premier lieu, mais on signale aussi le devoir de remettre une lettre de présentation au patient que l’on recommandera à un confrère, ou celui encore de donner les moyens au patient qui signale son intention de changer de chirurgien-dentiste comme à son futur interlocuteur, de disposer des informations nécessaires qui le concernent par la délivrance des éléments constitutifs du dossier.
Toute attitude visant à la discrimination d’un confrère ou à son dénigrement, du fait notamment qu’elle nuit à l’image de la profession dans son ensemble, est condamnée. En cas de litiges ou de doutes, il sera préférable, par exemple, de ne pas se prononcer devant le patient, et de contacter son/sa confrère en privé. Cependant, il reste essentiel de signifier que, d’après l’article de loi R.4127-264 (extrait du Code de déontologie inclus au Code de santé publique) : « Le chirurgien-dentiste peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients relevant de son art quel que soit leur chirurgien-dentiste traitant ».
À ce stade, il convient de rappeler en quoi consiste l’éthique professionnelle à laquelle se doivent les praticiens, en tant que représentants d’une profession médicale. Il va d’évidence que cette éthique se situe sur un point de vue moral engagé envers les patients et la société dans son ensemble ; cette éthique croise également la déontologie. Ses principes fondamentaux sont définis tel que suit :
-Respect catégorique des droits du patient,
-Respect catégorique de la personne du patient et de son intégrité,
-Devoir de vérité et de loyauté.
Il revient donc de la responsabilité du praticien de se tenir informé de ses droits et devoirs, parmi lesquels, dans le cadre de son activité, il fera figurer les « Droits des malades » (consulter la loi du 4 mars 2002 et les décrets ajoutés de 2005, notamment) et prendra en compte son obligation de recourir à la formation continue, dans le but avéré de se « tenir informé de l’évolution des dernières techniques ». Citons un extrait de l’article de loi L.4143-1 : « La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l’amélioration de la qualité des soins. La formation continue est obligatoire pour un chirurgien-dentiste en exercice […] ».
3- ENVISAGER LE PROJET PROFESSIONNEL : SE SAVOIR PRÊT
S’installer en tant que chirurgien-dentiste c’est tout d’abord, bien entendu, être porteur d’un projet professionnel, avec toutes les particularités que cela implique. Ce chapitre est le lieu indiqué pour insister sur la nécessité de la réflexion préalable. Aujourd’hui, les praticiens ont le choix entre les composantes d’un large éventail professionnel, or, de ce choix initial vont dépendre les réussites, les épanouissements et les contraintes d’une future activité professionnelle prévue pour s’étaler sur plusieurs décennies. Il s’agit de ne pas se laisser emporter par l’euphorie compréhensible qui caractérise le désir de s’installer chez tous les diplômés. Le conseil le plus approprié serait de ne pas se précipiter, de ne pas élire toute première proposition, qu’elle soit d’ordre associatif ou autre. Bien souvent, ce qui aura constitué le premier remplacement ou la première collaboration deviendra le quotidien du praticien, et, s’il est tout à fait possible que les conditions d’exercice lui conviennent, il est également possible que de nombreux tenants de la situation lui déplaisent finalement, c’est pourquoi il est important de considérer tous les aspects d’une installation.
L’on prendra en compte tous les aspects d’une installation professionnelle en toute conscience, en ayant préalablement répondu à des questions primordiales, synthèse entre des éléments de départ probants : quelle est la situation actuelle dans laquelle l’on se trouve ? Quel but vise-t-on ? Quels moyens envisage-t-on pour parvenir à ce but ?
Rappelons que le choix s’oriente vers les considérations suivante :
-Travail associatif ou ‘solitaire’,
-Exercice libéral ou mutuel,
-En spécialisation (parodontologie, implantologie, endodontie, etc.) ou en omnipratique,
-En vue d’une patientèle junior ou senior, etc.
L’on peut également considérer ces possibilités en pensant à l’exercice rural ou urbain, ou encore aux spécificités telles que devenir dentiste-conseil, ou enseignant.
Sur un plan plus pragmatique, que l’on pense racheter ou faire construire son cabinet, le préalable n’est pas moins important, et les seuls termes financiers ne doivent pas être considérés sous peine de rencontrer de nombreuses frustrations à l’avenir. Il convient de penser à la situation du cabinet, à son architecture, à son organisation, aux possibilités du local, etc.
Il est conseillé, quelle que soit la situation actuelle du praticien, qu’il soit ou non installé, qu’il soit ou non en exercice depuis longtemps, de se soumettre réellement à ces questions préalables, et d’y répondre en toute objectivité.
• Quelle est votre situation actuelle ?
Répondre à cette question vous permettra de défricher les champs des questions qui suivent, de faire un bilan sur votre quotidien, d’effectuer une remise en question fondamentale et de mettre en valeur les points positifs et les points négatifs de votre parcours professionnel. Le risque du ‘train-train quotidien’ n’est pas une chimère en l’occurrence ; beaucoup de chirurgiens-dentistes se rendent au travail le matin, répondent à leur devoir patient après patient et rentrent chez eux le soir sans s’être posé la question de leur épanouissement personnel dans la pratique de leur exercice professionnel. Sont notamment pointés, parmi les critères négatifs qui gênent cet accomplissement, la gestion du cabinet et l’exercice de la communication qui, bien entendu, ne coïncident par forcément avec le vocation de chirurgien-dentiste. Ainsi que nous l’avons démontré précédemment, de nos jours, communication et gestion vont de pair avec la pratique clinique : cela forme un tout. Il est donc nécessaire, pour le praticien, de faire le point sur sa situation actuelle.
• Quel est votre but ?
Autrement posée, cette question se traduirait : « Où voulez-vous aller ? ». Elle n’est pas la plus aisée à définir, et les réponses attendues se doivent, pour être efficaces, de n’être pas convenues. Il convient de définir des objectifs précis, qui accordent vos valeurs et vos attentes, quelles qu’elles soient.
• Enfin, de quelle façon atteindre le but que vous vous êtes fixé ?
Il s’agit ici de mettre en œuvre un plan d’action. Toute progression, toute évolution et par là, tout épanouissement sont conduits par l’établissement préalable d’objectifs précis, à la considération desquels tout praticien sera en état de mesurer sa marge de progression, d’envisager ses recours, d’entreprendre les actions coordonnées, etc.
Pour considérer au mieux les éléments qui régissent une installation en exercice, le praticien ne devra pas oublier de s’interroger sur le « pourquoi » de ses choix et de ses actions. C’est ainsi qu’il établira au mieux ce que l’on peut appeler la « philosophie de travail » du chirurgien-dentiste.
4- LÉGALITÉ ET RÉGLEMENTATION : PRÉALABLES À L’INSTALLATION
En France, il existe un grand nombre de réglementations et d’obligations légales qui ont pour but de régir la profession de chirurgien-dentiste. Il est nécessaire de s’informer préalablement à toute installation.
À citer en premier lieu, bien entendu, l’obligation de diplôme : « Le chirurgien-dentiste qui souhaite exercer sur le territoire français doit être titulaire du diplôme d’État de docteur de chirurgie-dentaire ou à défaut d’un titre équivalent ». (Se référer à l’article L.4111-1 et suivants du Code de la santé publique, disponibles sur le site www.sante.gouv.fr/documentation/textes01.htm).
Au premier rang des obligations légales interviennent les formalités à accomplir. Parmi celles-ci figurent l’enregistrement du diplôme à la préfecture (ou la sous-préfecture) ainsi qu’au greffe du tribunal dont dépend le cabinet ; l’inscription au tableau départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes et ce, quel que soit le mode d’exercice choisi. L’on peut s’acquitter de cette dernière formalité en procédant à l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception. Il conviendra également de ne pas oublier de transmettre à son Conseil départemental de l’Ordre la notification des contrats conclus dans le cadre de l’exercice de ses fonctions (il s’agit ici des contrats de recrutement autant que des accords relatifs à l’usage du matériel ou du local, étant sous-entendu, dans ce dernier cas, que le praticien n’en est pas le propriétaire).
Sont à retenir également, en termes de formalités obligatoires et préalables à l’installation du chirurgien-dentiste, la saisie des services de la Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale (DDASS), qui se chargeront de délivrer au praticien un numéro ADELI par le biais de l’Ordre : il convient ici de remplir un formulaire de demande d’attribution qui sera adressé à l’Ordre, lequel se mettra en relation avec les services de la DDASS.
Dans le champ des formalités entrent également la demande d’affiliation à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD), l’affiliation à la Caisse primaire d’assurance maladie, et l’immatriculation auprès des services de l’URSSAF.
Au titre des obligations, d’autre part, l’on retiendra les obligations fiscales (qui ne s’appliquent pas nécessairement à l’installation du praticien mais seront à remplir durant l’année qui suivra cette installation). Le chirurgien-dentiste s’astreint à déclarer annuellement (fonction du régime d’imposition choisi) ses recettes brutes, ses dépenses professionnelles d’après leur genre, et le montant net de ses revenus, par le biais du document 2035. Entrent dans le faisceau de la fiscalité de la profession : les obligations comptables, l’Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), la taxe professionnelle, les contributions sociales obligatoires (CSG et CRDS), la taxe sur les salaires, les droits d’enregistrement, la taxe sur la valeur ajoutée et, dans la mesure où elle s’applique, l’Impôt sur la fortune (ISF).
Cependant, les devoirs seuls n’entrent pas dans les obligations du chirurgien-dentiste, ses droits sont également concernés. Touchant sa protection sociale, il sera tenu d’opter pour les biais légaux qui régissent la profession en la matière. Ainsi, pour la plupart des chirurgiens-dentistes (qui participent au régime des praticiens conventionnés), l’assurance maladie sera prise en charge par les Caisses primaires d’assurance maladie départementales après inscription à l’URSSAF – l’on parle ici de l’Avantage Social Maladie (ASM). Les allocations familiales sont gérées elles aussi par l’URSSAF compétente. La CARCD gère pour sa part les plans de retraite des chirurgiens-dentistes. Rappelons à ce titre que l’inscription à la Caisse doit se faire dans le mois suivant le début d’exercice du praticien.
En tant que professionnel de santé, qu’il exerce dans un établissement public ou privé, le chirurgien-dentiste est considéré comme possiblement exposé à divers risques de contamination, c’est la raison pour laquelle la législation (art. 3111-4 du Code de la santé publique, arrêté du 6 mars 2007) prévoit qu’il soit soumis à une obligation de vaccination qui concerne l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.
Dans un autre registre, il convient de signaler que la couverture d’emprunt n’est pas obligatoire, mais elle est cependant indispensable et souvent exigée par les organismes de crédit.
En terme d’installation pratique, il est important de signaler que de nombreuses lois interviennent pour régir les divers cas de figure. Bien évidemment, la pratique de l’art dentaire est à dissocier de tout commerce, c’est la raison pour laquelle, notamment, il y a interdiction pour le praticien de s’installer dans un lieu qui se signale ou donne l’apparence de local commercial, tout comme il est interdit de s’intégrer au sein d’un complexe immobilier à vocation strictement commerciale. « L’exercice de l’art dentaire doit toujours se faire dans des conditions qui garantissent la qualité des soins et la sécurité des patients ».
Par suite, le Code de déontologie de la profession met en garde contre les situations de concurrence irrégulière ou abusive (consulter l’article R.4127-277 du Code de déontologie) et ouvre à divers permissions et arrangements eux-mêmes précisément encadrés.
Afin de procéder à son installation dans les meilleures conditions et s’assurer que la pratique de son art est possible en les locaux qu’il a choisis et parfaitement couverte par la légalité, le praticien devra se rapprocher du Conseil départemental de l’Ordre qui aura toute compétence pour le renseigner et le guider dans ses démarches.
À mentionner enfin, l’existence d’obligations touchant le matériel professionnel utilisé par le chirurgien-dentiste (obtention du permis de construire s’il y a lieu, obtention de l’agrément préalable au recours à des appareils radiologiques ou ionisants, obligation de déclaration en cas de fabrication de matériels médicaux sur mesure, obligation de recourir à des imprimés professionnels en règle, etc.). Il est à signaler que le chirurgien-dentiste est soumis à une obligation d’assurance, à la souscription d’un contrat pour l’élimination des déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI), ainsi qu’à la déclaration à la Commission Nationale de l’Information et des Libertés (CNIL – consulter le site www.cnil.fr) en cas de recours à un traitement automatique des données qui concernent ses patients.
Les chirurgiens-dentistes s’assureront de pratiquer leur profession en toute prudence en observant des précautions en matière de protection juridique (utile notamment en cas de litiges), de prévoyance (souscription de contrats divers à vocation de couverture des risques liés à la vie professionnelle et des risques liés à la vie privée et familiale), de perte d’exploitation (souscription d’un contrat auprès d’une compagnie d’assurances) et d’inscription à une association de gestion agréée (AGA). En tant que constituant des précautions, ces recommandations ne revêtent aucun caractère obligatoire, mais il est vivement conseillé au praticien de les observer dans la mesure où elles participeront à garantir sa sérénité professionnelle.
En conclusion, s’il est certain que le nombre des démarches auxquelles le praticien doit se soumettre et la nature des diverses obligations auxquelles il lui revient de souscrire sont rébarbatifs, leur étude et, à fortiori, leur application stricte ne sont pas superflues ; elles convergent vers l’établissement d’un environnement sécurisé pour d’évidentes raisons et évitent la survenance de troubles administratifs lourds susceptibles d’engendrer des conséquences disproportionnées.
5- CHOIX DE L’EMPLACEMENT
L’une des questions qui entre en jeu dans l’objectif d’installation du jeune praticien consiste, bien entendu, en le choix d’un emplacement d’activité.
À ce titre, de nombreux critères sont à considérer, parmi lesquels entrent des considérations aussi diverses et variées sur les plans personnel et professionnel que le climat, le type d’environnement, la présence, la proximité et la nature des écoles dans la région choisie, etc.
Il convient à ce stade de rappeler au futur praticien que rien ne peut l’obliger à élire telle ou telle région ; il dispose d’une totale liberté de choix en la matière et n’est pas même tenu de s’astreindre à dépendre de la faculté dans laquelle il a mené ses études. Au-delà des considérations purement personnelles qui entrent en ligne de compte et ne doivent surtout pas être mises de côté, les questions d’ordre concurrentiel, par exemple, interviennent et peuvent influer sur le choix final. Ainsi, la région parisienne est la plus prisée des chirurgiens-dentistes, on y observe les plus forts taux d’installations ou de réinstallations, mais il s’y joue également la concurrence la plus aiguisée. À l’inverse, les régions moins plébiscitées offrent des concurrences moins féroces, ce qui est un attrait certain. Le praticien gardera à l’esprit qu’il a également la possibilité, sous certaines conditions, de s’installer à l’étranger.
Quoi qu’il en soit, préalablement à son installation, le chirurgien-dentiste se devra de considérer de nombreux éléments et de juger de l’impact de ses choix sur sa vie personnelle et professionnelle, sur sa famille, sur ses perspectives d’avenir, etc. Il conviendra de mener une étude d’implantation, basée sur divers critères, d’abord personnels. Le chirurgien-dentiste se demandera :
-Quels critères comptent le plus pour lui en matière d’installation,
-Quels seront, pour lui, les marqueurs les plus significatifs de sa réussite,
-Le cabinet dont il rêve dans l’idéal a-t-il assez de crédibilité pour se traduire dans la réalité,
-Son caractère le pousse-t-il à entreprendre (à partir de zéro) ou pas,
-Quelles sont les motivations qui le poussent à avancer et progresser au quotidien, etc.
Dans une visée plus professionnelle, d’autres interrogations sont pertinentes :
-Le futur praticien désire-t-il accueillir la patientèle d’un confère ? Se sent-il plus porté à se créer la sienne propre ?,
-S’estime-t-il animé d’assez d’énergie et de motivation pour investir du temps dans la création d’un cabinet (et ainsi, de ne pas opter pour une reprise, souvent avantageuse),
-Considère-t-il pour important de ne pas être soumis à une concurrence directe ?,
-Envisage-t-il de préférer le lieu de son implantation à ces mêmes critères de concurrence ?,
-Pense-t-il à une patientèle ciblée ?,
-Quel budget pense-t-il consacrer à son projet ou, à défaut, quelle est sa capacité d’endettement ?,
-Combien de temps envisage-t-il de pratiquer sur le lieu de son installation ?, etc.
Ce qui est à noter, c’est que le cabinet du praticien devra être à l’image de la patientèle recherchée, et situé dans un quartier à sa proximité. Toutes ces considérations seront, dans l’idéal, partagées et envisagées avec les proches et la famille, directement concernés par les décisions à prendre.
En termes de considérations pratiques, l‘étude d’implantation couvrira de larges critères, une fois la région élue, il faut penser au type de commerces (haut de gamme, etc.) qui la caractérise, au genre de population, et évaluer ces éléments en fonction de ses propres valeurs.
Il est également évident que les données démographiques, le type d’odontologie choisi, la présence de confrères sont autant d’indicateurs d’importance. Il est possible de consulter divers organismes qui seront à même de renseigner le praticien qui cherche à s’installer ; les principaux informateurs étant le Conseil de l’Ordre de la région concernée – les services en renseigneront sur la situation de la région, sur la présence de praticiens, spécialisés ou non –, l’assurance maladie – apte à indiquer les lieux où ne se trouvent pas de chirurgiens-dentistes, par exemple ou, à défaut, le nombre de confrères déjà installés –, l’INSEE – excellent référent en matière de probabilités de développement d’une activité –, ou bien encore les mairies, Chambres de commerce et d’industrie, ANPE et Assedic.
À noter : les zones franches urbaines (ZFU) proposent des conditions d’installation facilitées augmentées de conditions fiscales indubitablement intéressantes, puisqu’elles sont inscrites au cœur d’un dispositif qui vise à « renforcer l’attractivité économique des territoires ». L’on consultera les plans ZFU dans les mairies des communes concernées.
En termes de considérations démographiques (sur le plan professionnel), il est bon de savoir que l’ONCD offre aux chirurgiens-dentistes de consulter les statistiques de répartition des praticiens en croisant un grand nombre de données ; âge des praticiens, type de pratique en odontologie, comportements synthétisés des populations vis-à-vis des soins dentaires, etc.
Le chirurgien-dentiste qui souhaite s’installer dans une région doit enfin penser, s’il y a lieu, aux configurations de son futur cabinet. À ce sujet, il convient de penser à tout ce qui pourra faire le succès de votre pratique en offrant les meilleures conditions à votre patientèle.
Premièrement, en cas d’acquisition d’un cabinet, il est nécessaire de bien se renseigner. Le futur praticien pourra opter pour la référence aux petites annonces, lesquelles sont répertoriées très largement dans des revues dédiées, hebdomadaires ou mensuelles. L’étude de ces annonces se doit d’être creusée et exhaustive ; l’on portera une attention toute particulière au détail : telle annonce est-elle récente ? Telle autre est-elle publiée depuis plusieurs semaines ? Si oui, le jeune diplômé aura à déduire des informations intéressantes : pour quelle raison les lecteurs ne prêtent-ils pas d’intérêt à cette annonce ? Est-ce le vendeur qui se montre particulièrement exigeant ?, etc.
Dans le cadre de ces recherches, il est également possible d’opter pour la consultation des sites Internet – et notamment les sites des agences immobilières, ou encore les sites spécialisés dédiés aux professions médicales – , eux-mêmes excellents dispensateurs d’annonces spécifiques.
Là encore, tout dépendra des intentions du praticien. Les agences immobilières seront d’excellent conseil dans le cas d’une construction ou d’une acquisition d’un local avec transformation, les sites spécialisés sont plus indiqués si l’on pense à la reprise d’un cabinet. Dans ce dernier cas de figure, il ne faut pas dédaigner l’idée de contacter directement les confrères installés afin de leur faire connaître l’intérêt que l’on porte à la reprise de leur cabinet : beaucoup de chirurgiens-dentistes ont en effet un plan de cession dont ils n’ont guère le temps de se préoccuper, et se montreraient intéressés par des offres en la matière.
Une fois les annonces listées et hiérarchisées, il conviendra de visiter les locaux, et d’être attentif à de nombreux critères. Le local concerné devra répondre aux exigences que le praticien s’était préalablement fixées ; il lui faudra prendre en compte des éléments tels que : l’accessibilité de l’emplacement sous toutes ses formes (situation et location, facilité d’accès physique, facilité à « repérer » le local, présence de parkings et proximité des différents types de transports), la présence de sites attractifs dans les environs (zones commerciales, zones de loisir, services publics, etc.).
Les projets associatifs seront bien entendu soumis à l’approbation de tous les membres concernés touchant l’acquisition, la transformation ou la construction des locaux d’exercice, et tout choix de terrain constructible sera lui-même soumis à des considérations propres (moyens d’accès routiers et autres, environnement, risques potentiels de nuisances notamment sonores ou de pollutions, nature du sol, etc.). Faire appel à des experts est une bonne alternative, d’autant que les coups de cœurs peuvent parfois faire oublier les défauts d’un lieu !
En conclusion, la question de l’installation, pour le futur praticien, est d’autant complexe que l’engagement sous-entendu est de longue durée et les implications, diverses et variées. Ne pas lésiner sur les efforts, prendre le temps de consulter beaucoup d’annonces, comparer divers lieux, envisager toutes les possibilités et les confronter aux questions essentielles est le meilleur des conseils. La pratique épanouissante de l’art de la chirurgie-dentaire dépendra souvent de l’examen attentif de ces questions ! Il est donc essentiel, pour rester objectif dans ses démarches, de se rappeler qu’en finalité, le cabinet du praticien devra posséder plusieurs qualités et présenter des atouts : il devra être « accueillant, moderne, hygiénique et efficace ! ».
6- LES OPTIONS D’EXERCICE EN CHIRURGIE-DENTAIRE ; ASPECTS NON JURIDIQUES
En médecine orientée chirurgie-dentaire, il existe de nombreuses options d’exercice. Si près de 90% des chirurgiens-dentistes installés le sont en libéral, d’autres ont fait le choix de l’enseignement, de la recherche ou du travail en laboratoire pharmaceutique ; certains praticiens couplent même, parfois, deux de ces profils. La plupart des jeunes diplômé(e)s est, au sortir des études, convaincu d’avoir fait son choix, il est cependant important d’envisager toutes les options qui s’offrent à soi. Bien souvent le premier choix conditionnera les premières années de la pratique de la profession, si ce n’est la carrière dans son entier.
Sans aborder les questions d’ordre juridique, l’on peut dire que les options en question sont définies tel que suit :
-Travailler en collaboration,
-Être son propre patron (avec ou sans personnel – assistant/secrétaire),
-Travailler en association au sein d’un cabinet dentaire,
-Travailler en association au sein d’un cabinet médical pluridisciplinaire.
Bien entendu, chacune de ces configurations comporte son lot d’avantages et d’inconvénients
La collaboration libérale :
La collaboration libérale, premièrement, apparaît comme une option avantageuse lorsque l’on vient de décrocher son diplôme. Concrètement, en quoi consiste-t-elle ? Il s’agit, pour le praticien, de rallier un cabinet existant et d’offrir un reversement d’une partie du chiffre d’affaire (CA) qu’il génère. Les bons points de cette option sont : la possibilité d’acquérir de l’expérience puisqu’il y a collaboration avec un(e) confrère expérimenté(e), la possibilité d’exercer à temps partiel, l’éventualité de travailler au sein de plusieurs cabinets et ainsi de se faire une idée du mode d’exercice qui convient le mieux. Il va sans dire que la collaboration libérale apporte également la satisfaction d’un faible risque sur le plan financier : bien souvent la patientèle est déjà établie et le jeune praticien n’aura aucun investissement à prévoir. S’il prend soin de sa gestion, il aura ainsi l’opportunité de se constituer un capital avant de procéder à sa propre installation. La collaboration libérale ouvre également la voie à l’association et permet de se confronter à ses avantages comme à ses éventuels inconvénients.
Exercice en solo :
Être son propre patron est encore un choix largement plébiscité par les chirurgiens-dentistes.
• Avantages : la liberté de choix et l’indépendance dans la pratique, bien entendu. Fonction des ambitions du praticien et de ses moyens, l’exercice en solo lui permettra de choisir lieux, équipements, matériels, ambiance, mais également, patientèle ; il lui assurera également de ne pas rencontrer de difficultés relationnelles avec un(e) confrère.
• Inconvénients : dans l’exercice en solo, ce sont les natures des avantages qui impliquent les inconvénients. Être son propre patron implique de prendre seul les décisions et de n’avoir personne à qui en référer. Si les bénéfices reviennent au seul praticien, la charge des éventuelles erreurs lui revient également. Sur un plan pratique, par exemple, il ne sera pas possible au praticien de partager les dépenses en cas d’acquisition d’équipements onéreux, sur un plan plus personnel, le partage avec des collègues, les rapports d’expérience, les échanges peuvent être amenés à manquer. Il faut considérer enfin que la qualité du service offert au patient peut pâtir d’une pratique en solitaire. Au final, il convient de se demander si, en tant que chirurgien-dentiste, l’on est prêt à devenir également seul chef d’une entreprise à part entière, avec les satisfactions et les contraintes personnelles et professionnelles que cela implique.
Exercice en solo, sans assistante :
•Avantages : concernant cette option, les avantages avancés sont principalement gestionnaires et financiers. Au-delà du fait que certains praticiens n’envisagent pas de travailler continuellement sous le regard d’un tiers, l’on avance les arguments qu’aucune charge salariale ni obligation de chiffre d’affaire ne sont à assumer, guère plus que ne sont à envisager les questions managériales : aucune gestion (fiche de paye, recrutement, licenciement, etc.). Les organisations des périodes et horaires d’exercice ne dépendent que du seul praticien, de même que les changements d’organisation.
•Inconvénients : ils sont nombreux. Se passer d’une assistante, pour le praticien, revient à assumer seul les charges annexes liées à la pratique autant qu’à la gestion du cabinet, et elles sont nombreuses (stérilisation, accueil des patients, gestion des rendez-vous, communication et relationnel, gestion des stocks, secrétariat, ménage, etc.). Il faut penser à l’impossibilité de communiquer, de se référer à un avis extérieur, autant qu’à l’improbabilité de se consacrer à plein temps à l’exercice de la profession. Privé d’assistante au fauteuil, le chirurgien-dentiste ne pourra prétendre à des travaux de chirurgie complexe. Par ailleurs, son CA sera limité.
Exercice en solo, avec assistante(s)/secrétaire(s) :
•Avantages : ils sont nombreux et consistent surtout en la mise en valeur du savoir professionnel du praticien, qui aura le loisir de se consacrer à son art – les tâches annexes étant déléguées – ainsi qu’à la pleine satisfaction de ses patients. Les travaux de gestion et d’administration ne dépendront plus du chirurgien-dentiste, de plus, les compétences d’une assistante sont telles qu’elles peuvent permettre au praticien d’être à la fois plus efficace et moins fatigué en fin de journée. L’optique d’avoir une personne avec laquelle partager les bons moments comme les moins bons est appréciable et constitue un argument de taille.
•Inconvénients : le praticien qui opte pour un exercice en solo avec assistante doit savoir qu’il assume par là même les charges et fonctions normales d’un employeur aussi bien que d’un responsable hiérarchique : « diriger, recruter, manager, écouter, encourager, former, valoriser, réprimander, licencier ». Enfin, il s’engage, quel que soit son chiffre d’affaires, à verser son salaire à son personnel, ainsi que le préconise la loi.
Association en cabinet dentaire (intégration d’une structure ou participation à sa création) :
Une option de plus en plus choisie par les praticiens, qu’elle fasse suite à une période de collaboration, à un exercice en cabinets séparés suivi d’un regroupement, etc.
• Avantages : dans ce cas de figure, les avantages ne sont pas difficiles à définir. Ils touchent au « management du cabinet » (réflexions partagées sur les questions de l’avenir du cabinet et de la gestion du personnel, etc.), aux « investissements partagés » (local, ameublement, équipement, etc. ; partage du secrétariat mais attribution d’une assistante personnelle, puissance d’achat auprès des fournisseurs, etc.), à la « collaboration technique » (possibilités de spécialisation individuelle, de réflexion commune sur les plans de traitement, dynamique d’encouragement professionnel mutuel, etc .), comme, enfin, à la « qualité de service au patient » (possibilités de formation professionnelle optimisées, meilleure gestion des urgences, etc.).
• Inconvénients : une association est un véritable engagement qui mérite d’amples réflexions préliminaires. Il convient de penser que la moindre des décisions et le moindre des choix concernant le cabinet, à l’avenir – aussi divers et variés soient-ils : locaux et leur style, décor, investissements, type de patientèle souhaitée et type de dentisterie pratiquée, etc. – seront des objets de considération commune. Les décisions communes impliquent des renoncements personnels auxquels il faut être prêt. Si, sur un plan professionnel, les patients choisissent leur praticien, l’image du cabinet associatif, elle, est commune et générale, il sera donc nécessaire de l’entretenir et de bien faire vivre cette structure commune : coordination des équipes et gestion des petits conflits, prise de responsabilité en cas d’erreurs, etc. Toute signature d’un contrat associatif engage les parties au respect des engagements pris, dans l’excellence et dans la durée.
Le chirurgien-dentiste qui envisage d’exercer en association devra se poser de nombreuses questions et y répondre avec application. Pour quelle(s) raison(s) pense-t-il à s’associer ? Qu’attend-il de son associé(e) comme de cette collaboration ? Quel(s) engagement(s) se sent-il prêt à prendre et à respecter ? Éprouve-t-il de la fierté à l’idée de s’associer à la personne choisie ?, etc.
Association en centre pluridisciplinaire (intégration d’une structure ou participation à sa création) :
À noter que cette option intervient plus souvent en milieu de carrière que dans les débuts.
• Avantages : ils consistent en la pluridisciplinarité elle-même, enrichissante et dynamisante, en la mise en commun des nombreuses options (accueil, parking, radiologie, secrétariat, etc.), en l’impact potentiel des négociations qui engagent le centre envers des acteurs extérieurs (fournisseurs, banques, etc.), comme en la possibilité de rentabilité accrue.
• Inconvénients : ici, les inconvénients sont plutôt des contraintes, elles-mêmes liées aux risques, qui sont plus élevés. Les personnes impliquées au sein de telles grandes structures sont plus nombreuses, ce qui multiplie d’autant la possibilité de voir survenir des désaccords ou des conflits. Chaque décision personnelle étant soumise à l’accord des parties concernées peut être plus longue à prendre. Les charges en terme de gestion sont plus élevées – la structure étant vaste – ce d’autant que le praticien n’en possède pas la maîtrise directe. Enfin, bien entendu, les engagements pris au départ envers la structure impliquent le chirurgien-dentiste dans des décisions collectives auxquelles il lui faudra se soumettre, même lorsqu’elles ne lui conviennent gère. L’intégration au sein d’un centre pluridisciplinaire implique de se sentir prêt à préférer le compromis aux décisions individuelles et d’être doué de qualités de communication indéniables.
Un des atouts majeurs de la profession de chirurgien-dentiste consiste en ce large panel d’options d’exercice, elles-mêmes caractérisées par la liberté de choix (mode, durée, emplacement, etc.). Une telle variété offre à tous les profils la possibilité de choisir le genre d’exercice qui conviendra le mieux à leurs personnalités, à leurs ambitions comme à leurs préférences.
Modes d’exercice et contrats :
Les modes d’exercice qui régissent la profession de chirurgien-dentiste et les types de contrats sont nombreux et variés. Il est conseillé de se reporter au site Internet du Conseil de l’Ordre : www.oncd.org, sur les pages duquel sont répertoriées les informations nécessaires en la matière.
Précisons que les principaux modes d’exercice sont définis tel que suit :
-Exercice en tant que non-titulaire d’un cabinet, groupant :
•L’exercice en tant que chirurgien-dentiste salarié (point qui concerne le statut d’étudiant ou de salarié, ou encore l’exercice au service d’une collectivité),
• L’exercice en tant que chirurgien-dentiste non salarié (collaboration libérale ; missions de remplacement, etc.),
-Exercice en tant que titulaire d’un cabinet, groupant :
•L’exercice libéral individuel,
•L’exercice libéral en groupe,
•L’exercice entre époux, etc.
7- EXERCICE LIBÉRAL : CRÉER OU ACHETER SON CABINET
Dans le cadre de l’exercice libéral, de nombreuses questions se posent quant au cabinet. Vaut-il mieux en faire l’acquisition ? Vaut-il mieux le créer ?
Ces interrogations interviennent sitôt que sont définis les lieu d’exercice, mode d’exercice et forme juridique de la future activité, cependant, elles sont préalables à l’installation proprement dite. Le mot d’ordre : ne pas céder aux impulsions, qu’elles soient coups de tête ou coups de cœur ! La question primordiale est la suivante : combien de temps le praticien envisage-t-il d’exercer dans le cabinet en question ? Bien des considérations dépendent de la réponse apportée à cette question. Chacune des décisions prises par la suite gagnera à être examinée et réexaminée.
Création d’un cabinet :
En tout premier point, considérons les risques. Ils interviennent en termes financiers (la patientèle n’étant pas encore créée et le praticien ayant contracté des dettes, les débuts sont souvent difficiles), relationnels (il faut du temps pour trouver ses marques et s’y retrouver sur les plans de la communication, qu’elle concerne les patients, ou encore le personnel et les associés s’il y en a), personnels (la famille du praticien est également engagée dans ce processus de création, réputé très demandeur en matière d’implication et de temps), et enfin, juridiques et administratifs (l’on peut être confronté à de mauvais choix touchant la forme juridique choisie ; la gestion des démarches administratives – impliquant la légalité – peut être source de stress).
Les considérations suivantes sont d’ordre plus pratique. Le praticien peut opter pour l’une des solutions suivantes : acheter son cabinet, louer un local, ou le faire construire. Quoi qu’il en soit, les avantages sont nombreux à créer son cabinet. Le chirurgien-dentiste sera son propre patron, les équipements dont il bénéficiera seront neufs, il aura choisi aussi bien l’emplacement de son cabinet que la configuration intérieure des locaux, il constituera lui-même son équipe, d’après ses propres critères.
Location d’un local :
Cette forme est principalement représentée par ses avantages en terme de flexibilité. Le praticien aura loisir de changer d’emplacement s’il le souhaite. D’autre part, les frais d’assurance et d’entretien sont moindres, ce qui implique un faible investissement initial (point d’importance en cas de création d’un premier cabinet).Quant aux inconvénients de la location, ils ont lieu lorsque le local loué ne convient pas exactement aux attentes du praticien (espaces restreints ou trop vastes, aménagements compliqués – notamment dans les cas de remise à neuf ou remise aux normes nécessaires : installations électriques et/ou plomberie, etc.).
L’on peut penser, en cas de location d’un local, à la formule dite du leasing ou crédit-bail (LOA : Loyer avec Options d’Achat). Dans ce cas, la banque reste propriétaire du bien et en fin de leasing, une option d’achat est proposée au praticien.
Devenir propriétaire :
Signalons tout d’abord que, dans le temps, les rapports financiers sont ici plus stables, comparativement à la location. Les conditions d’attribution des prêts sont plus aisées dans la mesure où la banque estime qu’elle pourra toujours réacquérir les murs. Outre les aspects financiers qui comptent pour beaucoup dans les avantages de cette solution, l’on peut penser à la flexibilité offerte : le praticien sera par exemple en mesure d’agrandir son cabinet s’il le souhaite et ce, sans interrompre son exercice.
À signaler qu’il reste encore très avantageux d’un point de vue fiscal d’acquérir un bien professionnel par le biais d’une Société Civile Immobilière (SCI).
Bien entendu, il existe différentes manières de devenir propriétaire de son cabinet, et ces biais sont à examiner. L’on pourra opter pour l’achat d’un local existant en copropriété (les frais annexes et non directement liés au cabinet – tels les frais de parking – seront ainsi répartis entre les divers propriétaires, cependant la présence d’un public en va-et-vient peut déranger les résidents de la propriété), on peut également penser à faire construire un bâtiment (se reporter au « Guide de l’installation d’un cabinet dentaire », édité par l’ADF), l’on peut encore préférer acquérir un bien existant.
Cette dernière option présente de nombreux avantages : une structure déjà établie et qui « fonctionne », un gain de temps (les démarches administratives liées à l’installation d’un nouveau cabinet, les phases de négociation avec le constructeur, l’installation des équipements et la constitution d’une équipe sont des éléments évités). Si la plupart du temps la reprise d’un cabinet dentaire s’avère, pour le praticien, synonyme de succès, la formule ne garantit pourtant pas ce résultat. Le futur praticien doit penser que ce dont il « héritera » pourra lui poser problème s’il n’examine pas soigneusement les différents aspects de la question. Les équipements présents sur place, par exemple, peuvent être fatigués, si ce n’est désuets, l’architecture du cabinet pourrait ne pas convenir au nouveau praticien, de même il lui faut envisager de travailler avec une équipe déjà en place, laquelle a des habitudes de travail, des attentes, des réflexes. Puis, c’est la patientèle elle-même qui peut éprouver des difficultés à vivre la transition.
Il convient donc d’examiner les points probants un par un et au cas par cas et notamment, de se pencher sur les raisons qui motivent la vente du cabinet en question. Il peut être intéressant de faire appel à une agence lorsque l’on pense à racheter un cabinet existant. S’il est vrai que les prix qui seront proposés seront légèrement plus élevés, s’il est vrai que le cabinet aura connu une période d’inactivité et que l’acquéreur ne pourra prétendre à une transition en douceur, des avantages sont cependant à prendre en compte : succès des cabinets concernés, intervention d’une tierce partie (notaire, avocats, etc.), gain de temps, etc.
8- QUESTIONS ARCHITECTURALES ET DE MATÉRIEL
La conception architecturale du cabinet dentaire a évolué durant ces dernières décennies. L’art dentaire a progressé, les innovations ont amené le recours à de nouveaux matériaux, les mesures sanitaires se sont multipliées, les patients tendent à devenir « consommateurs de santé », etc., autant d’éléments qui font bouger les lignes des critères d’installation.
Les éléments nouvellement pris en compte sont les suivants :
–La stérilisation : l’hygiène est une question plus que jamais d’actualité ; elle est également une considération primordiale aux yeux du patient. Son respect agira tel un véritable message non-verbal, ainsi, l’on estime que la salle de stérilisation, au mieux, doit être le centre névralgique du cabinet dentaire.
–L’informatique : bien que divisés sur la question de l’efficacité et du bien-fondé de l’informatisation de leurs cabinets, les chirurgiens-dentistes y sont malgré tout confrontés ; il faut dire que le recours à l’informatique « permet la gestion des fiches patients et l’utilisation de la radiologie numérisée et de l’imagerie ». Les espaces doivent donc être adaptés à ces nouveaux éléments.
–La communication : dans une approche globale de la pratique de l’art dentaire, il est à considérer que le cabinet en lui-même constitue le premier instrument de travail du praticien. En ce sens, il représente le premier contact que le patient aura avec son chirurgien-dentiste or, pour beaucoup de personnes, franchir le seuil d’un cabinet dentaire est source d’anxiété. C’est la raison pour laquelle l’agencement clair et spacieux, rassurant, du cabinet (notions d’accueil et de confort, espaces d’attente et de pratiques divisés, avec une « zone d’accueil et administrative » et une « zone clinique », etc.) est un élément essentiel et primordial. L’important, tout d’abord, est de mettre la patientèle en confiance, de rassurer par tous les moyens possibles.
Lorsque le jeune praticien s’installe, si nombreux sont les éléments qu’il lui revient de prendre en compte qu’il peut être pénible de s’y retrouver. Le moment est bien choisi pour insister sur l’importance de s’entourer, et de s’entourer des meilleurs : il ne faut pas hésiter à avoir recours à des professionnels qui sauront accompagner la création d’un cabinet dentaire à proprement parler autant que la création de l’entreprise qu’il représente, en vérité. Les deux sont indissociables. Le futur chirurgien-dentiste devra entrer en contact avec :
-Des banquiers,
-Des experts-comptables,
-Un organisme d’accompagnement (pour son organisation),
-Des architectes et/ou maîtres d’œuvre,
-Une société d’agencement de cabinet dentaire,
-Des artisans.
C’est après avoir rencontré et choisi ces différents intervenants qu’il lui sera temps d’établir son cahier des charges, de même qu’une chronologie précise des actions qu’il devra entreprendre :
-1. Réalisation des plans de la future structure et validation,
-2. Choix des matériels dentaires,
-3. Devis global des matériels,
-4. Réalisation des plans techniques concernant les matériels dentaires implantés dans chaque salle (ces plans ne pourront être réalisés que si l’on a préalablement choisi les types de matériels et les mobiliers),
-5. Appels d’offres aux artisans,
-6. Réalisation du planning des travaux en vue de fixer une date de livraison du cabinet dentaire achevé (après acceptation du devis),
-7. Mise en place du bilan prévisionnel du projet (il est fortement recommandé de faire établir ce dernier avec l’aide d’un cabinet d’expert comptable),
-8. Sollicitation des prêts bancaires,
-9. Coordination des travaux (réunions de chantier – après accord des emprunts),
-10. Réalisation des travaux (livraison complète généralement prévue en dix à douze semaines).
Afin de pouvoir suivre cette chronologie dans les meilleures conditions, il est nécessaire de visualiser ce qui devra constituer le cabinet dentaire idéal, dans sa version achevée, à savoir, en terme d’agencement :
-Les salles de soin,
-La salle de stérilisation,
-La salle de radiologie,
-La salle technique,
-Le coin hygiène,
-La salle de communication et de motivation,
-La salle de chirurgie,
-La salle d’attente.
Chacun de ces éléments devra être pris en compte séparément et examiné avec soin dans une optique à la fois globale et détaillée : durée dans le temps, fonctionnalité, concordance attentes/pratique, etc.
Si l’on ne perd pas de vue que le cabinet dentaire est en quelque sorte la « carte de visite » du praticien, l’on n’oubliera pas de prendre en compte les aspects esthétiques du cabinet, lesquels, à la vérité, vont lui permettre de respirer en ce sens qu’ils transmettront un message aux patients. L’image globale du cabinet reflétera, bien entendu, les goûts et la personnalité du praticien – qui est libre de ses agencements et de son décor en la matière – mais, étant entendu qu’elle dépendra également du type d’exercice choisi et du type de patientèle attendue, il est important de ne pas oublier que cette image appartient au patient. Matériaux choisis, ambiance, tons chaleureux, style classique ou style moderne, sobriété affichée, éléments décoratifs, tout doit être choisi et pensé pour illustrer les motivations du praticien, pour offrir confort et sécurité au patient, tout en évitant de franchir la frontière entre nécessité et luxe (qui pourrait entraîner des conséquences financières regrettables).
9- EMPLOYER ET MANAGER
Si, à l’évidence, de nombreux chirurgiens-dentistes rêvent de se concentrer sur leur métier et la pratique de leur art, il est cependant vrai que de nos jours, et dans les contextes actuels, exercer la profession de chirurgien-dentiste signifie également devenir employeur et/ou manager. Des envies, des attentes ou des nécessités, des droits et des devoirs motivent cet état de fait.
La première étape est donc « d’accepter d’être employeur », du point de vue du jeune praticien. Rappelons que la relation employeur/employé(e) est de nature contractuelle et se basera forcément sur le respect mutuel des règles pré-établies, mais elle est également humaine. Tout sera donc question d’écoute et de compromis, également sur la durée. Il faut penser que les situations personnelles du praticien autant que celle de son assistante, par exemple, seront amenées à évoluer au fil des ans, ouvrant de nouvelles voies ou impliquant de nouveaux impératifs : « arrêter de travailler à 16 h 00 et bénéficier de tous les mercredis et samedis risque d’être périlleux à mettre en place ; exiger des horaires de travail jusqu’à 19 h 30, six jours sur sept est tout aussi difficile à obtenir ! ».
L’on se référera souvent au contrat de travail dans le cadre de cette collaboration. La Convention Collective Nationale (CNN – N°3255 : applicable aux cabinets dentaires) définit qu’il existe cinq types de postes :
-Prothésistes dentaires (présentés selon leur degré de compétences),
-Assistante dentaire (stagiaire ou diplômée ; à noter : la différenciation entre assistante et assistante qualifiée ODF n’est plus d’actualité),
-Aide dentaire (stagiaire ou diplômée),
-Réceptionniste ou hôtesse d’accueil,
-Personnel d’entretien.
Trois critères définissent quant à eux la tenue d’un contrat de travail :
-Une prestation de services entendue dans le but de se procurer des revenus financiers,
-Une rémunération (en espèces ou/et en nature),
–Un lien de subordination juridique : en effet, l’exécution du travail de l’employé(e) se fait et doit se faire incontestablement sous l’autorité de l’employeur et ce, sans équivoque. Ce dernier retire de cette situation des droits et des devoirs, bien entendu. À lui d’établir des règles que son employé(e) se devra de respecter sous peine de sanctions (autorité réglementée et contrôlée légalement, il va de soi), à lui également de comprendre quelles sont ses responsabilités, engagées envers le ou les salarié(s) autant qu’envers les tierces-personnes.
Le management, d’un autre côté – c’est-à-dire l’art et la manière d’exercer son autorité d’employeur et de gérer son équipe – notion souvent personnelle et régie par une approche individuelle, se définit dans les grandes lignes par quatre aspects ou quatre étapes.
L’on distingue ainsi les aspects :
-1. DIRECTIF (diriger, structurer),
-2. PERSUASIF (mobiliser),
-3. PARTICIPATIF (associer),
-4. DÉLÉGATIF (responsabiliser).
Ces quatre aspects impliquent quatre étapes de travail :
-1. Définir avec précision le poste du ou de la ou des futur(e)s employé(e)s,
-2. Recruter le personnel,
-3. Former le personnel,
-4. Déléguer les tâches.
D’autres considérations s’imposent en termes de recrutement, de management ou de travail en équipe : philosophie du travail d’équipe (notions de réalisation personnelle et d’épanouissement de tous les acteurs engagés, etc.), travailler avec son conjoint (« Vivre et travailler en couple est un art qui se cultive »!), etc.
Enfin, il est important de ne pas négliger l’aspect des collaborations externes à la structure et pour cela, de choisir avec soin ces derniers acteurs (banquiers et conseillers juridiques, experts-comptables, architectes, distributeurs, confrères spécialistes, etc.).
10- ORGANISATION PRATIQUE DU CABINET : AU QUOTIDIEN
L’organisation du travail au quotidien et la gestion pratique du cabinet dentaire vont de paire et constituent des points primordiaux à considérer, puisqu’ils impliquent un épanouissement au jour le jour aussi bien qu’une réussite sur la durée.
Premier point important : le dossier du patient, soumis bien entendu au principe de confidentialité (mais sur lequel lui-même a tout droit de regard). Rappelons que « L’obligation du secret médical va bien au-delà des données présentes dans le dossier du patient. Elle couvre tout ce que le praticien, et les personnes qu’il emploie, ont pu apprendre au sujet d’un patient ».
Le dossier complet d’un patient doit comprendre :
-Les données initiales (document renseigné par le patient),
-Les données administratives (numéro de dossier, nom-prénom(s)-sexe du patient, numéro INSEE, date-lieu de naissance, adresse complète et code postal, numéros téléphoniques, profession, notification du médecin traitant et des autres professionnels de santé assurant la prise en charge du patient, dates du premier et du dernier rendez-vous),
-Les données sociales,
-Les données cliniques oro-faciales,
-Les autres données cliniques (schéma bucco-dentaire avant tout acte assorti des différentes évolutions amenées au cours de la prise en charge, documents relatifs aux examens complémentaires, plans de traitement, etc.),
-Les documents conservés, tels la fiche d’informations renseignée par le patient et signée de sa main, les doubles des ordonnances médicamenteuses, les devis, les échanges épistolaires tenus avec les autres professionnels de santé, etc.
Il est important de considérer que l’exercice de l’art dentaire se fait aujourd’hui, en quelque sorte conjointement avec le patient, qui participe à ces soins et en est l’un des acteurs primordiaux ; de plus, son droit à l’information est total et inaliénable : « la liberté de choix, le droit d’être informé, de consentir ou de refuser un examen ou un traitement, ainsi que le droit de demander réparation sont désormais inscrits dans les droits des malades ».
Second point d’importance : le contrôle des rendez-vous. Question cruciale et primordiale de laquelle dépendent toutes les journées de travail et leur bon déroulement. Chaque instant passé à son cabinet soumet le praticien à se tenir au meilleur de sa forme et de ses capacités or, il faudra, dans le réel, conjuguer avec les imprévus, les retards, les annulations. La prise de rendez-vous, assumée ou non par une ou des assistantes, est un art !, et une mauvaise gestion à ce titre entraîne des conséquences désastreuses sur divers plans. C’est pourquoi il est essentiel de tenir un agenda clair et efficace. Le carnet de rendez-vous s’inscrit donc comme un outil premier et indispensable. Il s’agit de l’utiliser efficacement : y recourir systématiquement, définir précisément la façon de le remplir et de s’y référer (et s’y tenir!), définir précisément la planification d’une journée de travail, etc.
L’on respectera quelque règles de base, telles que :
-N’attribuer qu’un seul rendez-vous à la fois et pour la même plage-horaire,
-Planifier des actes variés au cours de la journée,
-Hiérarchiser les rendez-vous d’après l’importance et l’urgence des interventions, etc.
Les points à faire figurer sur le carnet de rendez-vous définissent également le traitement optimal du patient. On y inscrira :
-Le nom et le prénom du patient,
-Une information détaillée sur le traitement (numéro de la dent à traiter, action à réaliser, etc.),
-Nom et qualité des intervenants possibles (s’il y a lieu).
Le praticien veillera à écrire clairement et lisiblement, et à conserver son carnet de rendez-vous hors de la portée de ses patients. L’organisation de son temps ne regarde que lui !
En termes d’organisation du cabinet et de pratique quotidienne interviennent également les questions délicates de l’argent (ici, il convient d’informer clairement et totalement le patient AVANT d’aborder la notion de coût ; il existe beaucoup de personnes prêtes à payer pour un soin de qualité et qui comprendront la valeur des honoraires, mais seulement si elles sont correctement informées des plans de traitement), et de la relation au patient (fidélisation).
À ce titre il est important de distinguer empathie et sympathie, d’une part, et d’autre part, de comprendre qu’une relation praticien-patient se construit et prend du temps à s’établir. On veillera tout d’abord à satisfaire le patient, bien entendu, à le connaître, à le comprendre de mieux en mieux, à lui donner confiance. Il est essentiel de ne pas le tenir à l’écart des choses qui le concernent : plus l’information circulera entre le chirurgien-dentiste et son patient mieux les choses iront et plus le relationnel sera épanoui.
Enfin, le praticien devra apprendre comment et dans quelle mesure il convient d’impliquer ses patients dans les processus qui les regardent. Il s’agit de ne pas oublier que le patient est acteur de ses soins ; c’est à lui que l’on demande une confiance totale, lui qui s’assied dans le fauteuil, lui qui doit suivre les directives qu’on lui donne. La question de l’éthique mise en corrélation avec la morale et les valeurs du praticien engage ce dernier à ne pas forcément mettre son patient au courant de tous ses choix et de toutes ses décisions pratiques, mais l’invite à instaurer un dialogue et à jauger les attentes de la personne, en veillant à sa mobilisation et à son éducation dans les termes du service proposé. Par exemple, la communication verbale est un facteur très important (éviter les mots compliqués et les termes techniques !) ; on pourra l’assortir de communication écrite en distribuant des fiches informatives, etc.
Information, communication, fidélisation : des critères d’épanouissement personnel et professionnel qui entrent en jeu dans la gestion pratique et quotidienne du cabinet, et qui demanderont du praticien engagement, patience et persévérance tout au long de sa carrière, pour des résultats optimaux et gratifiants.
11- GESTION ET PATRIMOINE
Pour terminer, il convient de ne pas faire l’impasse sur les termes de gestion professionnelle du cabinet du chirurgien-dentiste dans une visée patrimoniale. Nous l’avons vu et découvert, le professionnel de santé, aujourd’hui, est – à son corps défendant s’il le faut – un chef d’entreprise. Il doit penser, pour la bonne pratique de son art et qu’il le veuille ou non, en termes de concurrence, d’assurances, de mutualisation, de réputation également (exposition aux divers médias, etc.).
La question de la gestion financière d’un cabinet est souvent épineuse pour le praticien, pourtant, s’il s’astreint à certaines disciplines, il verra ses résultats s’en ressentir et le « stress administratif » diminuer considérablement.
Premièrement, il est utile de considérer chaque semaine « les indicateurs de vitalité [du] « cabinet-entreprise » en veillant sur des éléments tels que les dépenses effectuées et leur nature, le nombre de patients, le nombre d’heures travaillées, le CA, etc. Autant de points qu’il s’agit de ne pas compulser au mois de décembre seulement…
En bref, le chirurgien-dentiste devra opérer une planification financière (et se faire accompagner si besoin), différencier les divers niveaux de vie auxquels il peut prétendre, réaliser des analyses, équilibrer le ratio dépense/bénéfice, etc.
La question de la gestion du patrimoine intervient également à ce stade, puisqu’il est nécessaire de gérer les biens que l’on possède. Distinguons trois attitudes à adopter chronologiquement :
-1. Générer des revenus par le biais de son activité : pour pouvoir épargner !,
-2. Investir grâce à l’épargne réalisée : pour générer les revenus futurs !,
-3. Préparer la retraite au plus tôt.
Et pour cela, il convient de procéder par étapes :
-1. Faire un état des lieux,
-2. Définir des objectifs patrimoniaux,
-3. Établir une stratégie patrimoniale,
-4. Réfléchir aux investissements (choisir les produits dans lesquels investir).
L’on ne pourra que recommander, à l’occasion de ces questions pragmatiques d’abord un peu cavalier, de recourir à des experts de bon conseil, qui orienteront les choix. Gérer son patrimoine n’est pas une mince affaire !, il s’agit même d’une affaire très sérieuse, dont les points méritent autant d’être régulièrement révisés que d’être examinés un par un, consciemment, en toute clarté et connaissance de cause.
CONCLUSION
Force est de constater que de nos jours, un grand nombre de praticiens subit son métier au quotidien plus qu’il ne le choisit, ne l’acte et ne le dirige. Il apparaît cependant que « prendre le contrôle de sa vie professionnelle est la clé d’un exercice serein ». Pour ce faire cependant, tant d’éléments entrent en ligne de compte et sont, préalablement, à considérer !
Établir un équilibre entre aspirations écoutées et considérées et applications pratiques, tout mettre en œuvre pour parvenir à ses objectifs, voilà les défis qui attendent au quotidien le chirurgien-dentiste passionné par son métier, lequel, à l’instar de tout autre, recèle des difficultés et confronte à des embûches mais surtout, permet de retirer des satisfactions, d’expérimenter des joies et de construire un bonheur qui surpasse les pénibilités de tout ordre. Cultivons-donc la visée large et à long terme de notre parcours professionnel !